Acheter québécois, mission possible
Vous souhaitez encourager l’économie locale en achetant des vêtements, des meubles et autres produits québécois plutôt que chinois, américains ou mexicains ? C'est possible grâce à Kanuk, Le Château mais aussi d'autres marques de chez nous à découvrir!
Vivre en consommant uniquement des produits fabriqués au Canada ou au Québec. Le journaliste Frédéric Choinière (photo ci-dessous) a tenté l’expérience. Pendant un an, il n’a acheté que des biens manufacturés au pays, en vue de préparer la série documentaire Ma vie made in Canada (qui sera diffusée en septembre 2017 sur la chaîne Unis TV).
Son constat : il est à peu près impossible de trouver des produits électroniques et des électroménagers qui sont fabriqués au pays. Pour le reste, il a réussi à n’acheter que des objets qui le sont. « Je suis encore en vie et je n’ai pas le scorbut ! » rigole-t-il. Et s’il avait dû se procurer des produits québécois seulement ? « Cela aurait peut-être été un peu plus difficile, mais il reste encore beaucoup d’entreprises manufacturières dans la province », observe-t-il.
La preuve avec les entreprises que Protégez-Vous a rencontrées dans différents secteurs: alimentation, habitation, vêtements ou plein air... acheter local n'est plus un mirage!
>> MISE À JOUR: Nous avons publié en 2019 un grand dossier sur l'achat local, lisez-le ici: alimentation, alcool, produits d'entretien ménager, soins personnels, meubles, quincaillerie, véhicules, l'achat local c’est quoi et ce qui est le plus difficile à trouver.
Les consommateurs sont prêts à privilégier les produits locaux mais pas à n'importe quel prix. Et pourtant, produire au Québec coûte cher...
Le secteur manufacturier québécois est en déclin et beaucoup d’entreprises ont fait migrer leurs activités vers les pays émergents, où les coûts de production sont moindres. Cela n’est pas sans conséquence, et ce, tant des points de vue économique et social qu’environnemental.
Ces produits fabriqués à l’autre bout de la planète doivent en effet voyager sur des milliers de kilomètres, ce qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Quant aux travailleurs chinois, leurs salaires annuels excèdent à peine 12 000 $ alors que les semaines dépassent souvent 40 heures de labeur, rapporte le site de données économiques Trading Economics.
Pour toutes ces raisons, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) invitait les consommateurs à acheter des produits locaux lors d’une campagne diffusée en 2016. D’après cet organisme, si les citoyens dépensaient en moyenne 20 $ de plus par semaine pour des biens et services d’origine québécoise, ils contribueraient à créer jusqu’à 100 000 emplois.
Des experts interrogés par Radio-Canada ont toutefois mis en doute ces chiffres, mentionnant notamment que les entreprises de la Belle Province pourraient avoir du mal à accroître leur production à court ou à moyen terme. Le CPQ rappelle néanmoins son objectif : inciter les Québécois à opter, autant que possible, pour des produits d’ici plutôt qu’importés.
>> Testez vos connaissances! Répondez à notre quiz sur les produits québécois
Le prix: un facteur déterminant
Mais les Québécois sont-ils prêts à privilégier les produits « fleurdelisés » ? « L’achat local n’est pas qu’une tendance éphémère, estime Francine Rodier, professeure de marketing à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et chercheuse associée à l’Observatoire de la consommation responsable (OCR). C’est une lame de fond, tout comme le transport durable et la déconsommation. »
Une opinion qui s’appuie notamment sur l’édition 2016 du Baromètre de la consommation responsable de l’OCR, lequel révèle que 67 % des répondants ont privilégié l’achat de produits fabriqués dans la province au cours des 12 derniers mois.
Professeur de marketing à l’UQAM, François Marticotte est cependant sceptique : « Le fait qu’un produit soit local n’est habituellement pas le facteur le plus important pour les consommateurs, qui sont très individualistes. Ils achètent en fonction de leurs besoins et de ce qu’ils sont prêts à payer. »
La plupart des intervenants interrogés pour ce dossier s’entendent d’ailleurs sur ce point : les gens ne veulent pas débourser plus cher pour des produits d’ici. Du reste, c’est pour demeurer compétitives que plusieurs entreprises québécoises font fabriquer leurs biens en Asie.
« Ces compagnies créent tout de même beaucoup d’emplois chez nous, par exemple pour la conception et la distribution », souligne Marie-Claude Frigon, comptable associée et spécialiste en commerce de détail au cabinet Richter. Comme quoi vous pouvez encourager l’économie québécoise sans pour autant acheter uniquement des produits qui le sont jusque dans leur ADN.
Nous avons publié, il y a de cela une décennie, un dossier sur l’achat de produits québécois. Notre reportage nous avait permis de constater combien il pouvait être difficile d’en trouver dans certains domaines – en particulier dans les secteurs du meuble, des vêtements et de l’alimentation.
Dix ans plus tard, les choses ont-elles changé ? Pas tant que ça. Les meubles québécois sont nombreux, mais souvent mal (ou pas) identifiés en magasin. Par contre, en alimentation, des logos comme Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec s’affichent de plus en plus, rendant ces produits plus faciles à mettre dans nos assiettes.
Pour ce dossier, nous nous sommes donc concentrés sur des secteurs où il est encore possible de trouver des produits fabriqués ici (si on se donne la peine de chercher un peu !) : alimentation, habitation, vêtement, sport et plein air. Nous avons également trouvé des fabricants locaux qui se démarquent entre autres par leur notoriété, leur pérennité ou leur philosophie d’entreprise.
Il était bien sûr impossible de présenter tous les fabricants québécois dans ce dossier. Poursuivez vos recherches en visitant des répertoires web, mais aussi en questionnant les détaillants sur la provenance de leurs produits. Vous pourriez être surpris par la quantité de biens de consommation faits au Québec que vous découvrirez !
Répertoires de produits québécois
achetonsquebecois.com Ce site encourage les consommateurs à acheter des produits locaux pour « consolider et même augmenter le succès des entreprises québécoises ».
faitcheznous.com Spécialisé dans la mode, ce répertoire propose des vêtements dont la dernière transformation a été effectuée au Canada, et dont plus de 50 % du prix de production a été engagé au pays.
ideecadeauquebec.com Pour trouver des idées de cadeaux 100 % québécois. Vous pouvez faire des recherches basées sur le type de personne à qui le cadeau s’adresse (homme, femme, enfant, etc.) et sur votre budget.
signelocal.com Ce très beau site vous permettra de découvrir des créateurs et des producteurs locaux dans plusieurs catégories : alimentation, art, beauté, enfants, maison, etc.
ACHETER QUÉBÉCOIS DANS LE DOMAINE DU SPORT ET PLEIN-AIR
Vous êtes passionné de vélo ou de sports nautiques ? Réjouissez-vous : le Québec compte plusieurs entreprises réputées dans le domaine des activités extérieures !
Dans les magasins de plein air (comme La Cordée), les marques québécoises ne manquent pas. Vous pouvez notamment y acheter des sacs Cocotte, des kayaks Pelican ou des vélos Devinci et Argon 18, de même que des vêtements Lolë, Orage et Kanuk.
« Ces marques font vibrer la fibre québécoise », lance Yves Robert, directeur du marketing à La Cordée. Dans ses succursales de Laval, de Montréal et de Saint-Hubert, le magasin propose des produits provenant de plus de 30 entreprises du Québec. Les consommateurs peuvent les repérer en cherchant les drapeaux québécois (ou canadiens) sur les présentoirs ou sur les fiches des produits présentées en ligne.
« Dans le [domaine du] vélo, les marques Devinci et Argon 18 sont de belles sources de fierté. Ces entreprises font maintenant partie des ligues majeures sur le marché international », affirme Yves Robert. Comment expliquer une telle popularité ? « Même si nous avons tendance à nous percevoir comme un coin de pays nordique et froid, le vélo s’est beaucoup développé chez nous dans les dernières années, constate-t-il. Il y a de plus en plus de pistes cyclables et de clubs [de cyclistes]. C’est un phénomène planétaire, mais c’est très fort ici. »
Selon lui, certains nouveaux créneaux – comme les vélos de gravelle (gravel bikes), qui s’apparentent à des vélos de route, mais qui peuvent rouler sur des chemins de terre – sont particulièrement bien adaptés à nos conditions. Devinci et Argon 18 ont su tirer profit de cette tendance en proposant plusieurs modèles.
Conçus au Québec, mais…
Dans bien des cas, notamment du côté d’Argon 18, les vélos de marque québécoise sont conçus au Québec, mais fabriqués en partie ou en totalité en Asie. Certaines entreprises achètent même des vélos 100 % conçus et fabriqués en Asie, puis elles se contentent d’y apposer leur logo.
« Si vous voulez créer une ligne de vélos qui s’appelle Bergeron, par exemple, rien ne vous empêche de vous rendre en Asie, de choisir des modèles de vélos génériques et de mettre votre nom dessus », explique Jacques Sennéchael, rédacteur en chef du magazine Vélo Mag. Le lieu de fabrication est habituellement indiqué sur les vélos. En cas de doute, n’hésitez pas à questionner les fabricants et les détaillants à ce sujet.
Le portrait est identique dans le monde du sport nautique, où plusieurs entreprises québécoises sont actives. Certaines, comme Pelican et Abitibi & Co., conçoivent et fabriquent leurs produits ici. D’autres, comme Kayak Distribution, mettent en marché des produits conçus chez nous, mais confectionnés en Asie.
Abitibi & Co.: nouvelle génération
Établie à Rouyn-Noranda, Abitibi & Co. a été fondée en 2015 par deux jeunes entrepreneurs, Jean-Daniel Petit et Guillaume Leblanc, qui ont racheté Mid-Canada Fiberglass et Fibre de verre Abitibi. Les cofondateurs ont ainsi pu reprendre certains modèles de canots et kayaks qui avaient déjà fait leurs preuves sur le marché, en plus de procurer une touche de modernité et une philosophie écologique à l’entreprise.
Abitibi & Co., qui fabrique moins de 1 000 embarcations par année, ne cherche pas à accroître sa production. « Nous offrons des paroduits haut de gamme, fabriqués à la main au Québec, explique Jean-Daniel Petit. Notre structure d’entreprise n’exige pas de faire des ventes exponentielles. Nous n’avons pas effectué d’achats majeurs de machinerie qui nécessiteraient une production élevée pour rentabiliser l’investissement. »
« La raison première pour laquelle nous avons lancé l’entreprise, c’est pour inspirer les gens à aller profiter des grands espaces, soutient M. Petit. Une fois dans la nature, ils réalisent que ça leur fait du bien et qu’il faut prendre soin de l’environnement. » Abitibi & Co. organise d’ailleurs chaque année des corvées de nettoyage de rivières et de boisés.
Marinoni: l’artisan
Depuis 1975, Giuseppe Marinoni fabrique au Québec des vélos à partir de tubes d’acier qui sont importés d’Italie. Lors de notre visite à son atelier de Terrebonne, en février dernier, l’homme de 79 ans était encore à l’ouvrage. En grande forme, il parcourt toujours plus de 10 000 km à bicyclette chaque année.
L’entreprise qui porte son nom compte aujourd’hui 16 employés et produit environ 500 vélos chaque année. Sa spécialité : les produits sur mesure en acier et en titane. Ainsi, un consommateur qui se présente à l’atelier de Terrebonne peut faire fabriquer un modèle en fonction de ses mensurations, en plus d’en choisir la couleur et les composantes (de marque Shimano ou Campagnolo). Bien sûr, il faut être prêt à y mettre le prix – soit de 2 000 à 3 000 $ au minimum dans le cas d’un vélo en acier.
Marinoni propose aussi des produits en carbone. Les cadres sont fabriqués en Asie, mais la peinture et l’assemblage sont effectués à Terrebonne. Selon Paolo Marinoni, le fils de Giuseppe, le fait que l’entreprise dépense très peu en publicité et vende directement aux clients lui permet d’offrir des modèles haut de gamme à bon prix.
ACHETER QUÉBÉCOIS DANS LE DOMAINE DES VÊTEMENTS
Chine, Bangladesh, Vietnam, Cambodge, Sri Lanka… Il suffit de lire les étiquettes des vêtements pour constater que le nom du Canada n’y apparaît que très rarement. Et pour cause : compte tenu des coûts de production nettement plus bas en Asie, la plupart des produits vendus au pays proviennent aujourd’hui de ce continent.
D’ailleurs, au Québec, le nombre d’emplois dans le secteur de la fabrication de vêtements est passé de plus de 45 000 en 2002 à moins de 11 000 aujourd’hui.
Difficile, dans un tel contexte, de mettre la main sur des vêtements confectionnés à proximité. Tristan et Le Château fabriquent encore environ 30 % de leurs morceaux dans la province. Kanuk et m0851 produisent quant à eux l’essentiel de leurs vêtements et accessoires à Montréal. Ces entreprises sont toutefois des exceptions.
« Il y a toujours un intérêt et une fierté à porter des produits d’ici, croit Jean Airoldi, designer de mode et chroniqueur. Par contre, le prix est un obstacle. Les gens ne sont pas prêts à payer 75 $ pour une chemise faite au Québec quand ils peuvent en trouver une à peu près identique fabriquée en Asie pour 22 $. » Les vêtements signés Jean Airoldi, qui sont confectionnés en Chine et vendus dans les boutiques de la chaîne Aubainerie, se détaillent pour la plupart moins de 50 $.
« Aujourd’hui, le prix est le nerf de la guerre, confirme Jocelyn Bellemare, professeur à l’École supérieure de mode de l’UQAM. La concurrence est très forte. Zara et H&M produisent des vêtements à des coûts incroyablement bas. Des jeans qu’on payait 100 $ il y a 20 ans se vendent maintenant moins de 70 $. »
Juste prix et durabilité
« Les gens sont habitués à débourser de bas prix qui ne reflètent pas les coûts environnementaux et sociaux de la fabrication en Asie, souvent effectuée par une main-d’œuvre sous-payée », constate la designer Marie-Eve Emond, dont les vêtements de marque Betina Lou et Marmier sont dessinés et fabriqués à Montréal.
À contre-courant de la tendance fast fashion propulsée justement par les H&M et Zara de ce monde, la jeune femme conçoit des vêtements de facture classique, qui peuvent être portés plusieurs années sans se démoder. Il faut toutefois être prêt à y mettre le prix – par exemple 90 $ pour un t-shirt, 130 $ pour une jupe et 180 $ pour une robe.
Fait intéressant : Kanuk ainsi que Betina Lou et Marmier, dont les boutiques ont pignon sur rue à Montréal, offrent une garantie à vie sur leurs produits. Les consommateurs peuvent y faire réparer leurs vêtements et donc en prolonger la durée de vie. On est bien loin de la mode jetable !
Kanuk : un look rafraîchi
Les manteaux Kanuk ont beau être chauds et durables, leur design n’avait pas changé d’un iota depuis des années, jusqu’à ce que l’entreprise décide enfin, vers 2015, de revoir leur coupe. Kanuk a même travaillé avec le designer québécois Philippe Dubuc pour concevoir certains manteaux. Aujourd’hui, ses vêtements sont au goût du jour, et le fabricant n’a rien à envier à des concurrents comme The North Face ou Columbia… sauf, peut-être, leurs profits !
« Nous sommes compétitifs sur le marché, mais nos marges bénéficiaires sont plus minces, explique Richard Laniel, président de Kanuk. La soif de profits a mené plusieurs concurrents vers la fabrication en Asie, mais on voit souvent une différence dans la qualité des vêtements faits là-bas plutôt qu’ici. »
En février dernier, Richard Laniel nous a fait visiter la boutique et l’atelier de Kanuk, situés sur la rue Rachel, à Montréal. Au rez-de-chaussée, dans un local vaste et moderne, des employés se préparaient pour la vente de fin de saison. Au premier étage, une designer travaillait déjà sur la collection 2018-2019. « Aujourd’hui, les gens veulent avoir chaud sans sacrifier le style, observe le président de Kanuk. Nous avons fait beaucoup d’efforts sur le design pour essayer de rattraper l’industrie. Nos manteaux sont maintenant plus ajustés. » Au deuxième étage, des dizaines de couturiers et couturières, penchés sur leurs machines, s’affairaient sur des manteaux. « Parmi notre centaine d’employés, beaucoup travaillent ici depuis 15 ou 20 ans, souligne Richard Laniel. Ce sont de vrais artisans. »
En affaires depuis 45 ans, l’entreprise – qui a longtemps vendu des manteaux uniquement à son magasin de Montréal – étend aujourd’hui son réseau de distribution ailleurs au Québec, au Canada et même en Europe. « L’an prochain, nos vêtements seront offerts dans une boutique sur les Champs-Élysées, à Paris », dit fièrement l’homme d’affaires.
Le Château : l’avantage local
Près du tiers des vêtements vendus dans les magasins Le Château, principalement des habits pour hommes et des robes, sont faits au Québec. « Il y a des avantages à fabriquer nos produits ici, affirme Franco Rocci, vice-président principal de l’entreprise. Cela nous permet de réagir vite pour suivre les tendances. » Il poursuit : « Quand nous passons une commande en Asie, il faut s’y prendre trois mois à l’avance, et faire venir au moins 600 000 morceaux. En fabriquant localement, nous pouvons produire en petites quantités – par exemple 60 unités – pour tester le marché. »
Cela dit, comme tous les détaillants de vêtements, Le Château évolue dans un environnement hautement compétitif et difficile, où les fermetures de commerces sont courantes. L’entreprise a d’ailleurs annoncé l’an dernier qu’elle allait mettre la clé sous la porte de 40 boutiques d’ici 2019. Comme la plupart de ses concurrents, Le Château concentre maintenant ses efforts sur Internet. Selon Franco Rocci, les ventes en ligne de l’entreprise augmentent de 50 % par année et comptent aujourd’hui pour 10 % de ses recettes totales.
La bonne nouvelle : vous pouvez acheter québécois sans même sortir de chez vous ! D’ailleurs, la plupart des grands détaillants de vêtements de la province, de l’Aubainerie à Clément en passant par Dynamite et Laura, ont pris le virage web.
>> À lire aussi: Commerce en ligne: à la recherche des produits québécois
ACHETER QUÉBÉCOIS DANS LE DOMAINE DE l'HABITATION
« Quatre-vingt-dix-huit pour cent du volume d’un bâtiment peut, si son propriétaire le souhaite, être entièrement québécois », affirme Emmanuel Cosgrove, fondateur d’Écohabitation, un organisme spécialisé dans l’habitation écologique.
Du sous-sol au grenier, la très grande majorité des matériaux peuvent donc être extraits (bois, ardoise, etc.) ou usinés (fenêtres, isolants, etc.) au Québec. C’est le cas, par exemple, des maisons certifiées LEED – une norme de construction écologique –, dont les matériaux doivent être locaux.
« Au Québec, nous sommes assez choyés, car nous fabriquons beaucoup de matériaux », ajoute Emmanuel Cosgrove. Il cite en exemple le bois d’œuvre et le bois franc, les revêtements, les produits isolants, les fenêtres, les panneaux de finition intérieure, les armoires et comptoirs de cuisine, le carrelage d’ardoise ou de granit, la peinture, etc.
Les 2 % de matériaux qu’il est plus difficile de trouver ici proviennent souvent d’Asie, d’Europe ou de nos voisins du Sud et touchent à certaines composantes, comme la robinetterie, l’éclairage, la céramique, les systèmes d’échangeur d’air ou la domotique, indique Richard Darveau, président de l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT).
Plutôt « made in Canada »
Dans un contexte de forte concurrence internationale, en particulier asiatique, plusieurs entreprises québécoises parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à des produits haut de gamme. C’est le cas, par exemple, de MAAX (bains et cabines de douche), de Venmar (hottes de cuisine, ventilateurs d’entretoit, etc.), de Riopel (revêtements extérieurs), de Planchers Mercier (planchers de bois franc et plancher d’ingénierie) ou encore d’Igloo et de Benolec (isolants à base de cellulose).
« Mais il est très rare de voir les entreprises
du secteur de la construction mettre de l’avant l’origine québécoise de leurs produits », indique Emmanuel Cosgrove. De nombreuses entreprises misent avant tout sur l’exportation et sur l’appellation « made in Canada ». Elles auraient pourtant tout intérêt à indiquer leurs origines, croit Richard Darveau, car les consommateurs québécois manifestent un intérêt marqué pour des produits de construction locaux. Un sondage réalisé en 2013 par son association révèle ainsi que 67 % des personnes interrogées étaient prêtes à payer plus cher pour un produit fabriqué au Québec.
Richard Darveau voit dans les résultats de cette enquête l’occasion de travailler sur la « fibre locale », en particulier en favorisant la mise en place d’outils permettant aux consommateurs de repérer en magasin les produits québécois. « Les grandes bannières et les acteurs de l’industrie sont prêts depuis longtemps à avoir un étiquetage comme on en trouve déjà dans le secteur agroalimentaire », croit-il.
Meubles : une question de visibilité
Pour Pierre Richard, président-directeur général de l’Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ), l’enjeu de la visibilité des produits fabriqués ici est crucial. Jusqu’à présent, l’étiquetage permettant de retracer la provenance d’un meuble « découle de campagnes de marketing ponctuelles et non d’obligations liées à la réglementation », précise-t-il. Or, selon un sondage Léger réalisé pour l’AFMQ à la fin de 2016, 98 % des consommateurs interrogés disaient avoir une opinion positive des meubles conçus au Québec, et la moitié seraient prêts à en acheter. Une bonne chose pour les fabricants de meubles québécois, mais malheureusement, une très faible proportion des personnes sondées (14 %) estimait que ces produits étaient « accessibles et faciles à trouver ».
L’AFMQ a donc commencé à travailler en collaboration avec les manufacturiers et les détaillants afin de les encourager à mieux identifier les meubles du Québec. Cela aidera donc les consommateurs à en trouver qui soient « made in Québec »… et, on l’espère, à les acheter.
Glendyne, l’ardoise des Appalaches
Le Québec regorge de matières premières. Dans le secteur de la construction, ces richesses font de la province un acteur de premier plan non seulement en Amérique du Nord, mais aussi à l’international. Des produits comme l’ardoise naturelle Glendyne – extraite et taillée à Saint-Marc-du-Lac-Long, dans la région du Témiscouata – séduisent, à l’autre bout du monde, les consommateurs japonais et australiens, entre autres.
« Nous sommes la seule ardoisière d’envergure au Québec et au Canada, explique Stéphane Therrien, directeur général de Glendyne. Nous sommes également très présents en France et au Royaume-Uni, où l’utilisation de l’ardoise de toiture est beaucoup plus courante qu’en Amérique du Nord. » Au Québec, l’entreprise – qui compte 120 employés – mise davantage sur des produits de design, comme le carrelage, les parements muraux et les comptoirs de cuisine, ou encore les dallages extérieurs.
Gris foncé avec une nuance de bleu, dense et très résistante aux intempéries, cette ardoise des Appalaches présente des caractéristiques qui en font un produit de qualité et particulièrement durable. « La durée de vie d’une toiture peut aller au-delà de 75 ans et, sur les produits de carrelage, nous ne recommandons même pas l’ajout d’un scellant », souligne Richard Therrien. La seule transformation de l’ardoise est physique, au moment de la taille, et, dans un souci environnemental, « notre objectif est de valoriser 100 % de la matière qui est extraite, car ce serait un non-sens de n’utiliser qu’une partie de la pierre, comme certaines ardoisières le faisaient par le passé».
Meubles Huppé : design et savoir-faire
En 1967, Huppé fabriquait des coffres de cèdre. Cinquante ans plus tard, l’entreprise de Victoriaville fondée par trois frères – Raymond, Aurèle et Sylvi
o Hamel – a considérablement élargi son horizon et élaboré de nombreuses gammes de produits : tables de salon, unités murales, mobiliers de salle à manger et de chambre à coucher. Rachetée en 2010 par Jean-François Nolin, un ancien banquier qui rêvait d’avoir son entreprise, Huppé a amorcé un virage en douceur vers un design réinventé. « Je me suis entouré de gens plus compétents que moi », explique Jean-François Nolin. Le designer québécois Joël Dupras a joint l’équipe de Huppé, et plusieurs collaborations ont aussi vu le jour avec des designers étrangers.
L’entreprise compte désormais 45 employés, une équipe de vendeurs et une soixantaine de sous-traitants qui s’occupent de la fabrication des meubles. « Chacun d’entre eux est spécialisé dans une essence de bois et dispose des machines adaptées pour la travailler », explique le président de Huppé. Il poursuit : « Mon objectif était que nous soyons capables de fabriquer au Québec des meubles de qualité équivalente [à celle des] meubles italiens et scandinaves, les leaders dans le domaine. Grâce à notre savoir-faire et au design de nos produits, nous y parvenons. » On trouve les meubles Huppé dans plusieurs chaînes de magasins locales (Maison Corbeil, Mobilia, Signature Tanguay, La Galerie du Meuble).
Près de 45 % des ventes de l’entreprise sont aujourd’hui réalisées aux États-Unis, alors qu’elles n’en constituaient que 9 % en 2010. Dans sa ligne de mire : le marché asiatique, et plus particulièrement la Chine et la Corée du Sud. « Le marché québécois représente environ 20 % de notre chiffre d’affaires, et le reste du Canada, 25 % », précise Jean-François Nolin. Un virage qui porte fruit puisque, depuis le rachat de l’entreprise en 2010, son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre.
ACHETER QUÉBÉCOIS DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION
Que ce soit sur les tablettes des grandes surfaces ou sur les étals des marchés, il est facile aujourd’hui de trouver des aliments du Québec ou qui sont préparés ici.
Depuis la parution en 2007 du dernier dossier de Protégez-Vous consacré aux produits du Québec, la situation a beaucoup évolué dans le domaine de l’alimentation. Les produits québécois ont fait une très nette percée dans les rayons des supermarchés comme sur les étals des maraîchers – et, au bout du compte, dans le garde-manger des consommateurs.
Pour preuve : le boum des produits étiquetés « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au Québec », deux logos qui permettent de repérer en un clin d’œil les produits d’ici. Ils sont passés de quelques centaines au début des années 2000 à plus de 22 000 en 2016, détaille Marie Beaudry, directrice générale d’Aliments du Québec. C’est sans compter les déclinaisons biologiques – « Aliments bio du Québec » et « Aliments bio préparés au Québec » –, qui représentent 6 % de l’ensemble des produits certifiés par l’organisme sans but lucratif.
Toute la filière représentée
Aliments du Québec compte aujourd’hui 1 200 membres (producteurs, producteurs-transformateurs et transformateurs) et couvre l’ensemble du secteur agroalimentaire : fruits et légumes, lait et produits laitiers, produits de la mer, volailles et viandes, produits acéricoles, produits alimentaires transformés, etc. « L’adhésion à notre organisme se fait sur une base volontaire, précise Marie Beaudry. Nous en enregistrons une centaine chaque année, dont plus du quart affirment que cela fait partie intégrante de leur stratégie marketing. »
Les producteurs et transformateurs québécois souhaitent ainsi que la provenance de leurs produits soit certifiée par Aliments du Québec, afin de répondre non seulement aux attentes des consommateurs, mais aussi aux exigences des distributeurs. « En 2007-2008, IGA a été l’un des premiers joueurs de l’industrie à réclamer de ses fournisseurs qu’ils adhèrent à Aliments du Québec, se rappelle Marie Beaudry. Les autres grandes chaînes d’alimentation ont suivi, ce qui a permis de rendre le logo beaucoup plus visible en magasin. »
Un consommateur sur trois
Aujourd’hui, le tiers des consommateurs québécois consacrent plus de 40 % de leur budget alimentaire hebdomadaire à des produits locaux – désignés par les logos « Aliments du Québec » et « Québec Vrai » (produits biologiques certifiés), ou directement achetés chez le producteur. C’est ce que rapporte l’édition 2016 du Baromètre de la consommation responsable, publié par l’Observatoire de la consommation responsable (OCR). Une situation qui ne surprend pas Francine Rodier, professeure de marketing à l’UQAM et chercheuse associée à l’OCR. « L’étiquetage a un fort impact sur le choix des consommateurs et, de plus en plus souvent, ils achètent des produits clairement identifiés », dit-elle.
Même s’ils ne sont pas identifiés « Aliments du Québec », de nombreux produits de niche du Québec parviennent à séduire les consommateurs. C’est le cas, par exemple, de huit gins faits ici, dont certains ont même été primés à l’international ces dernières années. Il en va de même pour des produits associés à des appellations régionales, comme le homard de la Gaspésie ou l’agneau de Charlevoix.
Toutefois, il y a encore place à l’amélioration en matière d’identification des produits, croit Francine Rodier : notamment celle des fruits et légumes vendus au détail ou des poissons pêchés au Québec, mais dont la provenance n’est pas clairement affichée en supermarché.
>> À lire aussi: Évaluation de 13 gins québécois
Un aliment du Québec, qu’est-ce que c’est ?
Pour être certifié « aliment du Québec », un produit doit être soit entièrement québécois (une fraise de l’île d’Orléans, par exemple), soit composé d’au moins 85 % d’ingrédients d’origine québécoise (un plat cuisiné, par exemple). Dans ce dernier cas, tous les ingrédients principaux doivent provenir du Québec. De plus, toute la transformation et l’emballage du produit doivent être effectués ici. Par ailleurs, pour être certifié « aliment préparé au Québec », un produit doit être entièrement transformé et emballé dans la province. Et, lorsque les ingrédients principaux sont disponibles au Québec en quantité suffisante, ils doivent être utilisés.
La Milanaise : la filière blé
Lorsque Robert Beauchemin et Lily Vallières ont fondé la meunerie La Milanaise, en 1982, ils avaient déjà en tête l’idée de produire de la farine biologique. À l’époque, au Canada, l’appellation « agriculture biologique » n’était pas encore encadrée, se souvient Robert Beauchemin. Trente-cinq ans plus tard, l’entreprise créée dans le village de Milan, en Estrie, a fait bien du chemin.
« En 2006, nous avons ouvert une usine à Saint-Polycarpe, Les Moulins de Soulanges, destinée à produire des farines à partir de grains 100 % québécois issus de l’agriculture raisonnée [qui prend en compte la protection de l’environnement] », explique Robert Beauchemin.
Il ajoute : « Cette usine est devenue notre vitrine d’expérimentation, car c’est à partir de là que nous avons commencé à travailler avec les agriculteurs sur la qualité de leurs blés et sur les variétés les mieux adaptées aux différentes réalités agronomiques des régions. Nous avons progressivement dressé une cartographie des différentes caractéristiques boulangères des blés du Québec. » Certains blés sont par exemple plus appréciés des boulangers pour la pâtisserie, d’autres pour la fabrication du pain.
La Milanaise a mis au point un service d’accompagnement des agriculteurs afin qu’ils se détournent de l’agriculture conventionnelle ou intensive et qu’ils privilégient une approche raisonnée ou bio. « Au début, ils trouvaient très risqué d’éliminer les herbicides, les pesticides et les fongicides, et ils craignaient pour leurs récoltes. Mais la donne a changé, et de 12 agriculteurs dans notre réseau en 2006, nous sommes passés à 300 », précise Robert Beauchemin.
Aujourd’hui, La Milanaise est devenue le plus gros acheteur de blé destiné à la consommation humaine au Québec. Une nouvelle usine a été inaugurée en 2016 à Saint-Jean-sur-Richelieu, et le groupe compte maintenant plus de 80 salariés. Même si ses farines sont principalement destinées au secteur de la boulangerie, La Milanaise est également vendue en épicerie. Les consommateurs québécois représentent 15 % de son chiffre d’affaires.
Chalifoux, laitier de famille
La Laiterie Chalifoux, c’est l’histoire d’une famille québécoise. Depuis sa fondation à Sorel en 1920, quatre générations s’y sont succédé. L’entreprise, qui compte aujourd’hui 175 salariés, produit lait, fromages, yogourts, crème fraîche, beurres et crème sure sous la marque Riviera.
Difficile, d’ailleurs, de passer à côté des petits pots de yogourt en verre de cette marque qui ornent les tablettes des épiceries depuis 2015. Le produit phare de la Laiterie Chalifoux s’inspire de la longue tradition européenne dans le domaine des produits laitiers, explique Martin Valiquette, directeur général de l’entreprise. « Nous avons revu l’ensemble de la marque Riviera, dont le positionnement était trop local, précise-t-il. En deux ans, nous avons lancé plus de 50 nouveaux produits et élargi notre diffusion au-delà de la grande région de Sorel et de Montréal. »
L’entreprise exporte aujourd’hui 20 % de ses « produits ultrafrais » (yogourts, crèmes, etc.) dans le reste du Canada et aux États-Unis. La part de l’exportation a d’ailleurs beaucoup progressé ces dernières années, précise le directeur général : « Dans les autres provinces, nos produits séduisent pour leur côté haut de gamme et leur signature européenne. C’est le cas en particulier de nos fromages suisse et parmesan. » Quant au lait, il est encore majoritairement consommé dans la grande région de Sorel et à Montréal.
« Les Québécois sont très fiers de leur lait, il fait partie de leur ADN. Les gens veulent savoir que ce qu’ils boivent provient d’un terroir local. Nos producteurs sont de la région de Sorel, produisent un lait sans OGM, et nous l’avons clairement indiqué sur nos produits », conclut Martin Valiquette.
>> MISE À JOUR: Nous avons publié en 2019 un grand dossier sur l'achat local, lisez-le ici: alimentation, alcool, produits d'entretien ménager, soins personnels, meubles, quincaillerie, véhicules, l'achat local c’est quoi et ce qui est le plus difficile à trouver.

En santé, les particularités physiques des femmes ont longtemps été rédu...

Travailler sur un ordinateur portatif peut causer des maux de dos et de...

Vous planifiez de courtes vacances ou encore un long congé sabbatique? P...
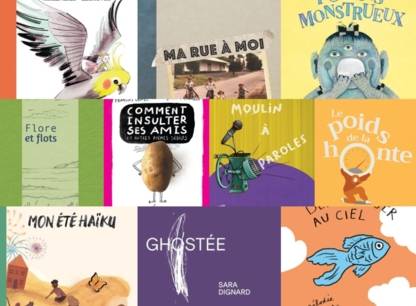
La Journée mondiale de la poésie est célébrée chaque 21 mars. Protégez-V...
















L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.