Comment acheter votre premier véhicule électrique
Autonomie, capacité de la batterie, subventions provinciales et fédérales, coût en électricité, fiabilité, rentabilité à long terme : voici ce que vous devez savoir avant d’acheter un véhicule 100 % électrique ou hybride branchable qui répond vraiment à vos besoins.
Choisir un véhicule adapté à vos besoins
L’autonomie qu’il vous faut
La vitesse de recharge
Rentabiliser votre achat
La fiabilité
Quelques éléments techniques
6 conseils pour faire le bon choix
AJOUT: Depuis la publication de cet article, les montants des aides gouvernementales ont été modifiés. Nous avons donc ajusté l'information concernant les subventions.
Voies réservées, faible coût énergétique, ponts à péage gratuits (autoroutes 25 et 30), stationnements réservés : l’achat d’un véhicule électrifié est alléchant. Des voitures économiques – comme la compacte Nissan Leaf – au robuste Ford F-150 Lightning en passant par les clinquantes Tesla, il en existe une centaine de modèles.
Même si, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le nombre de véhicules électriques et hybrides branchables en circulation a plus que doublé entre 2019 et 2022, ils ne représentent encore que 3 % des véhicules sur les routes du Québec.
Avant d’acheter, informez-vous sur les tactiques de vente que vous rencontrerez, car la pénurie de véhicules abolit votre pouvoir de négociation et augmente vos risques de faire face à des pratiques douteuses. Sachez aussi que les délais peuvent être longs; certains acheteurs s’inscrivent même sur plusieurs listes d’attente.
Selon un sondage mené en décembre 2022 par Équiterre dans le cadre de son programme Roulons électrique, depuis avril 2021, 55 % des gens avaient attendu leur véhicule électrique ou hybride branchable moins de six mois, et 30 % ont patienté entre six mois et un an.
Vous êtes prêt à passer à l’électrique? Vous trouverez ici les renseignements de base à connaître. Gardez en tête que nos conseils concernent les véhicules neufs et que les subventions gouvernementales permettent de retrancher jusqu’à 4 000 $ des prix mentionnés ci-dessous. Voyez aussi notre essai de quatre véhicules électriques, notre test de bornes de recharge et notre article sur les réseaux de bornes de recharge publics.
Un véhicule adapté à vos besoins
Le modèle idéal est celui qui correspond à vos habitudes quotidiennes, vos voyages occasionnels et vos besoins en hiver, d’après le président de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), Simon-Pierre Rioux. Alléchants grâce au faible coût de l’électricité au Québec, les modèles 100 % électriques permettent en moyenne de rouler 400 km avec une seule charge en été, mais moins en hiver (voyez « L’autonomie qu’il vous faut » plus loin).
En matière d’autonomie, l’offre va du Mazda MX-30 (à partir de 44 760 $), qui permet de parcourir 161 km par charge, à des modèles comme la Tesla Model Y longue autonomie (à partir de 71 982 $), qui peut rouler 531 km sur une seule charge en été. « Les Québécois parcourent en moyenne 65 km par jour, donc n’importe quel véhicule électrique leur convient – y compris l’hiver – s’ils ont une borne à la maison ou au travail », estime Simon-Pierre Rioux.
De leur côté, les véhicules hybrides branchables représentent un bon compromis entre la voiture 100 % électrique et celle à essence; il s’agit d’un choix idéal pour les gens qui font de longues escapades dans des endroits peu desservis par les bornes publiques.
Jesse Caron, expert automobile à CAA-Québec, souligne toutefois que leur efficacité sur l’autoroute varie d’un modèle à l’autre : « Certains basculent rapidement en mode à essence, alors que d’autres continuent sans problème avec le moteur électrique. » Offrant 60 km d’autonomie en mode électrique, la Toyota Prius Prime neuve (à partir de 41 024 $) fait partie de nos « meilleurs choix » depuis l’année-modèle 2018.
Un mot sur les véhicules hybrides classiques : leur batterie se recharge automatiquement lorsque vous roulez, de sorte qu’ils consomment jusqu’à 30 % moins de carburant qu’un modèle à essence, et jusqu’à 50 % en conduite urbaine. Cependant, il n’y a pas moyen de les brancher, et ils ne sont pas admissibles aux subventions. Selon Jesse Caron, il s’agit malgré tout d’un bon choix si vous avez difficilement accès à une borne de recharge ou si vous voulez prendre rapidement possession de l’auto.
Véhicule 100 % électrique
• Subventions : 4000 $ (modèle neuf respectant le plafond de prix) ou 2000 $ (modèle usagé, sous certaines conditions)
• Moteur : électrique (aucune vidange d’huile)
• Autonomie : de 161 à plus de 600 km, mais 400 km en moyenne
• Avantages : faible coût énergétique; moteur silencieux; aucune émission de gaz à effet de serre à l’usage; entretien peu dispendieux
• Inconvénients : nécessité de planifier les arrêts pour la recharge; aucune option de rechange si vous n’avez pas accès à une borne; réparations et entretien des composants mécaniques et électriques limités aux concessionnaires et à un petit nombre de garages indépendants
• Idéal pour : courtes ou moyennes distances; gens ayant une borne chez eux ou au travail
Meilleurs choix de Protégez-Vous : Hyundai Ioniq 5 (51 652 $ et plus); Hyundai Kona électrique (47 251$ et plus); Kia EV6 (50 559 $ et plus); Tesla Model 3 (56 982 $ et plus)
Véhicule hybride branchable (hybride rechargeable ou PHEV)
• Subventions : 1000 $ ou 2000 $ (modèle neuf respectant le plafond de prix)
• Moteurs : un électrique, l’autre à essence (vidange d’huile requise)
• Autonomie : comparable à celle d’un véhicule à essence, car le moteur à essence prend le relais quand la batterie électrique est déchargée.
• Avantages : possibilité de rouler avec de l’essence si la batterie électrique est déchargée; moins cher à l’achat qu’un modèle 100 % électrique
• Inconvénients : faible autonomie du moteur électrique (de 27 à environ 72 km pour les modèles 2023); calendrier d’entretien semblable à celui d’un véhicule à essence
• Idéal pour : longues distances; déplacements dans des zones dépourvues de bornes
Meilleur choix de Protégez-Vous : Toyota Prius Prime (41 024 $ et plus)
L’autonomie qu’il vous faut
Porte-parole d’Hydro-Québec pour la mobilité électrique, Jonathan Côté considère que les gens ont tendance à surestimer leurs besoins, de sorte qu’ils paient pour une batterie qui offre une grande autonomie, mais qui est rarement utilisée à plein rendement. « D’un point de vue financier, il est plus avantageux d’opter pour une batterie dont l’autonomie correspond à vos habitudes, quitte à arrêter à une borne rapide les rares fois où vous roulez au-delà de sa capacité », croit-il.
Pour calculer l’autonomie qu’il vous faut, y compris l’hiver, Jonathan Côté vous recommande d’ajouter une marge de 35 % ou 40 % à vos déplacements habituels. Faites vos calculs en gardant en tête que d’autres facteurs influencent l’autonomie – la vitesse, l’état des pneus, le poids à bord, la conduite plus énergivore sur l’autoroute, etc. – et qu’il est déconseillé de vider complètement la batterie.
Un sondage de Protégez-Vous mené en 2022 sur un petit échantillon de 185 répondants conclut que les véhicules entièrement électriques qui sont dotés d’un traditionnel élément chauffant perdent en moyenne 31 % d’autonomie l’hiver, alors qu’on parle d’une perte de 27 % pour ceux qui ont une pompe à chaleur. Lorsque le mercure descend sous les -20 °C, les pertes grimpent respectivement à 40 % et à 36 %.
Parmi les méthodes permettant d’atténuer le problème, celles que privilégient nos répondants sont le préchauffage du véhicule et l’utilisation des sièges et du volant chauffants, des éléments qui équipent la plupart des véhicules récents.
La vitesse de recharge
Le temps de recharge dépend surtout de la capacité de la batterie (en kilowattheures, ou kWh) et de la puissance de la borne (en kilowatts, ou kW). Avant de choisir un véhicule, il est primordial de vérifier si sa vitesse de recharge concorde avec vos habitudes. Par exemple, peu de voitures sont en mesure de profiter de toute la puissance des bornes publiques – encore rares – de 800 volts (V). Parmi celles qui y parviennent, les Kia EV6 et Ioniq 5 peuvent passer de 10 à 80 % en 18 minutes et ajouter 100 km d’autonomie en 5 minutes en chargeant à 350 kW, selon leur conctructeur.
« La vitesse est importante si vous rechargez votre véhicule exclusivement sur la route, mais avec une borne à la maison ou au travail, cela ne change pas grand-chose », nuance toutefois Blandine Sebileau, chargée de projets à Équiterre et coordonnatrice du programme Roulons électrique.
« Si vous faites souvent des voyages plus longs que l’autonomie du véhicule, vous devez décider si la vitesse de recharge est un élément important, ajoute Simon-Pierre Rioux. Mais n’oubliez pas que certains arrêts permettent de recharger l’auto sans attendre à côté de la borne, par exemple à une halte routière ou à l’épicerie. » À garder en tête : l’hiver, la recharge prend plus de temps.
Rentabiliser votre achat
Même en tenant compte des subventions, il y a lieu de constater que le prix des véhicules électrifiés est habituellement plus élevé que celui des modèles équivalents à essence. Ils ont cependant une très faible dépréciation prévue selon l’APA, ils coûtent moins cher à entretenir et, surtout, le « plein » d’électricité revient beaucoup moins cher que celui en essence (quoique l’écart s’amenuise considérablement si vous rechargez toujours le véhicule sur une borne publique).
« Plus vous roulez, plus l’achat devient rentable », résume Jonathan Côté, d’Hydro-Québec. Ainsi, il est habituellement possible de rentrer dans vos fonds en quelques années, surtout si vous roulez 20 000 km par année ou plus.
Un sondage mené en 2019 et en 2020 par nos confrères américains de Consumer Reports auprès de milliers de propriétaires conclut que le coût d’entretien et de réparations des modèles entièrement électriques est 50 % moins élevé que pour ceux à essence. Directeur de l’APA, George Iny croit que cet avantage pourrait être moindre au Québec, à cause de la corrosion en hiver et parce que l’offre en matière d’entretien est plus restreinte qu’ailleurs, tout en coûtant plus cher. Néanmoins, ces statistiques sont évocatrices.
Quant aux hybrides branchables – qui ont deux systèmes sous le capot et un calendrier d’entretien semblable à celui des autos à essence –, les données n’étaient pas suffisantes pour émettre une conclusion.
Comme son nom l’indique, l’outil Évaluer vos besoins du site web de Roulons électrique permet de déterminer quel véhicule électrique pourrait vous convenir selon votre kilométrage annuel et votre budget.
Pour approfondir vos démarches, consultez aussi nos guides Autos neuves et Autos d’occasion, qui présentent des véhicules électriques et hybrides branchables évalués de manière indépendante.
La fiabilité
Les pièces liées précisément aux aspects électriques du véhicule sont souvent exclusives au constructeur, donc plus rares et plus chères. Selon un sondage mené en 2022 par la firme J.D. Power, les véhicules électriques et hybrides branchables connaissent plus d’ennuis que les modèles à essence, soit 240 défauts par 100 véhicules (comparativement à 175 pour ceux à essence).
Par ailleurs, un sondage effectué par Protégez-Vous en 2021 auprès de 474 propriétaires de véhicules électriques et hybrides branchables conclut que, hormis la direction et la suspension – les problèmes les plus fréquents –, les défaillances les plus communes concernent les bruits et les fuites d’air ou d’eau, les accessoires électriques et les témoins lumineux ainsi que la climatisation et le chauffage. Les composants majeurs comme le moteur, la batterie, la transmission, le système de propulsion et le système d’alimentation du carburant (modèles hybrides), quant à eux, sont peu problématiques.
Quelques éléments techniques
Batterie. La fiabilité inconstante des batteries a longtemps été montrée du doigt, mais Jesse Caron, de CAA-Québec, souligne que celle des véhicules récents s’est nettement améliorée. Une perte d'autonomie de 1 à 3 % par an est souvent mentionnée pour les nouvelles batteries, mais cette estimation simplifiée ne fait pas l’unanimité, car de nombreux facteurs entrent en jeu.
La plupart des batteries sont assorties d’une garantie de huit ans ou 160 000 km, et les constructeurs assurent souvent les consommateurs qu’elles fonctionneront à au moins 70 % de leur capacité pendant cette période (une perte annuelle de près de 4 % est donc tolérée).
George Iny constate de son côté que la fiabilité varie beaucoup d’un modèle à l’autre : « Par exemple, les batteries des Ford Focus électriques ont connu beaucoup d’ennuis dans le passé, alors que celles des Tesla sont fiables. Mais quand on doit la remplacer sur une Tesla – souvent en raison d’un sinistre –, ça coûte au moins 15 000 $. » Peu importe le constructeur, les batteries sont souvent difficiles à trouver.
Système de freinage par récupération d’énergie. Ce système recharge en partie la batterie quand vous freinez ou relâchez l’accélérateur, de sorte que les freins traditionnels sont peu sollicités et que les disques et plaquettes durent plus longtemps. Pour éviter la rouille sur les freins, Jonathan Côté suggère de les utiliser de temps à autre. George Iny recommande aussi, une fois par année, de les faire lubrifier et dégripper (démonter et nettoyer).
Pneus. Selon Consumer Reports, les pneus d’un véhicule électrique doivent supporter plus de poids que ceux d’un véhicule à essence, et des accélérations plus rapides qu’avec ce dernier; ils ont donc tendance à s’user plus vite. Assurez-vous de choisir des pneus qui respectent les recommandations du constructeur. Sachant que des pneus usés diminuent l’autonomie du véhicule, ne tardez pas à les remplacer au besoin.
Suspension et direction. Pour des raisons semblables à celles qui ont été mentionnées ci-dessus, la suspension et la direction des véhicules électrifiés peuvent être sollicitées plus fortement que du côté des véhicules à essence. Il s’agit d’ailleurs des bris les plus fréquents, selon notre sondage mené en 2021.
Pannes d’électricité. Tout d’abord, sachez que les véhicules à essence subissent aussi les conséquences d’une panne de courant, car l’absence d’électricité rend la plupart des stations-service non fonctionnelles. Cela dit, vous pouvez toujours recharger votre voiture électrifiée dans une prise de courant standard chez un ami qui a de l’électricité grâce au chargeur portatif fourni avec l’auto.
Antirouille. Si vous désirez traiter votre voiture avec un antirouille, optez pour une entreprise spécialisée en véhicules électriques et hybrides. Des constructeurs en interdisent l’application sous peine d’invalider la garantie (plusieurs l’interdisent aussi pour leurs véhicules à essence). Toutefois, selon l’APA, vous avez avantage à le faire appliquer quand même. L’organisme souligne que si le constructeur refusait d’appliquer la garantie, il devrait alors prouver que c’est l’antirouille qui a causé les dommages.
6 conseils pour faire le bon choix
1. Conduisez une auto avec son propriétaire grâce au programme de jumelage de l’AVEQ. Vous obtiendrez alors le point de vue d’un utilisateur et non celui d’un vendeur qui connaît parfois mal son produit. D’autres options pour essayer un véhicule électrique : les concessionnaires, divers événements ou salons, la location auprès d’un particulier (par le biais de Turo, par exemple) ou d’une entreprise, etc.
2. Profitez de l’expertise d’organismes comme l’AVEQ (membre Platine, 120 $/an), CAA-Québec (Classique, 93 $/an) ou l’APA (77 $/an), qui incluent dans leurs forfaits un service téléphonique pour vous aider avant, pendant et après l’achat, par exemple dans l’évaluation de vos besoins; le choix du véhicule; l’utilisation des bornes; le choix d’un garage spécialisé, courtier ou concessionnaire; etc. Renseignez-vous sur l’éventail des services offerts.
3. Utilisez une application comme Chargemap ou Circuit électrique pour simuler vos itinéraires et les temps de recharge afin de vérifier si le véhicule convoité convient à vos habitudes, comme le suggère Blandine Sebileau, chargée de projets à Équiterre.
4. Participez aux ateliers et webinaires destinés aux premiers acheteurs et échangez avec des propriétaires passionnés sur des groupes Facebook.
5. Lisez la brochure Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins (gratuite sur roulonselectrique.com) ainsi que Le guide pratique de l’auto électrique… et plus!, de Daniel Breton et Pierre Langlois, qui date de 2021, mais qui constitue un bon point de départ (prix : 33 $).
6. Évitez les mauvaises surprises : informez-vous du montant de la prime d’assurance – parfois plus élevé que pour un véhicule ordinaire, mais pas toujours, selon Jesse Caron, de CAA-Québec – en demandant une soumission auprès de trois assureurs avant d’acheter l’auto.
À lire aussi
Articles de Protégez-Vous
Tous nos articles sur les véhicules électriques et hybrides
Les meilleurs véhicules électriques de l'année
Montant des subventions gouvernementales pour véhicules électriques
Voitures hybrides et électriques : 10 histoires portées devant les petites créances
Guides et liens pertinents
Calculatrice du coût énergétique (électrique, hybride, essence) – Hydro-Québec
Calculatrice du coût énergétique (électrique, hybride, essence) – CAA
Outil de recherche pour les cotes de consommation – Ressources naturelles Canada
Comparatif de l'autonomie en hiver de 21 véhicules électriques – Association des véhicules électriques du Québec
Étude américaine sur l’autonomie de 7 000 véhicules l’hiver et l'été (en anglais) – Recurrent (à noter que le froid aux États-Unis est moins intense qu’ici)

Prenez le temps de magasiner vos assurances : quelques heures pourraient...

Essie, Sally Hansen, OPI, BKind, Looky… Les vernis à ongles sont très po...
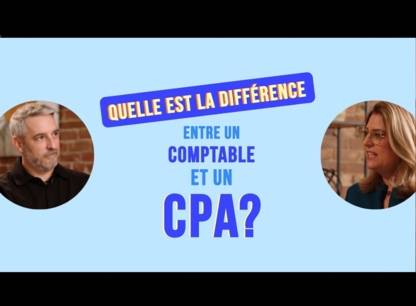
Notre journaliste s’entretient avec Geneviève Mottard, CPA et présidente...

Vous adorez les jeux de société mais n’êtes jamais assez nombreux pour v...





