Comment choisir une bonne crème solaire
Que vous optiez pour une crème, une lotion, un vaporisateur ou un écran en bâton, vous devez d’abord comprendre les allégations qui figurent sur les emballages des écrans solaires. Voici comment interpréter les mentions comme : bloque les rayons UVA et UVB, FPS, résistant à l’eau, crème à large spectre, avec ou sans nanoparticules, protège les océans...
Ne vous fiez pas uniquement aux écrans solaires
Recommandé par les dermatologues : un FPS de 30 ou plus
Quelle est la différence entre des FPS de 30 et de 50 ?
Large spectre et protection contre les UVA
Résistant à l’eau ou à la transpiration
Faut-il craindre les écrans chimiques ?
Le point sur les nanoparticules
Crème minérale ou chimique : laquelle est la plus efficace ?
Crème, lotion, vaporisateur (spray) ou bâton ?
Quand et comment appliquer un écran solaire ?
Vous employez déjà de la crème solaire ? Mettez-en plus.
Et l’après-soleil ?
Peu de gens le savent, mais le cancer de la peau est la forme la plus courante de cette maladie. « Au Québec, on continue d’en traiter des centaines de cas chaque semaine », indique le Dr Joël Claveau, dermatologue à L’Hôtel-Dieu de Québec et spécialiste du mélanome, qui est témoin au quotidien des conséquences des rayons ultraviolets (UV) sur la peau. « Malgré cela, les gens sont encore mêlés au sujet des écrans solaires et ont besoin de se faire rassurer sur leur sécurité », poursuit l’expert. Christine Lafforgue, maitre de conférences en dermopharmacologie à l’Université Paris-Saclay, insiste sur le fait qu’une crème solaire est une « protection » et non pas un produit facilitant le bronzage !
Ajoutez la multitude de produits sur le marché, et les études qui mettent régulièrement la population en garde contre certains ingrédients contenus dans les écrans solaires. Difficile, dans ce contexte, de faire un choix éclairé.
Pour vous aider, nous vous présentons les caractéristiques à rechercher dans un écran solaire, de même que les grands principes à respecter pour vous protéger des rayons nocifs du soleil. Nous vous invitons aussi à consulter les fiches des 23 produits que nous avons testés pour trouver une crème solaire efficace et abordable.
Ne vous fiez pas uniquement aux écrans solaires
Comptez seulement sur les crèmes solaires pour vous protéger du soleil est une erreur, martèlent les experts. Pour limiter les dangers liés aux rayons UV, rien de tel que fuir le soleil ou vous couvrir, particulièrement de 11 h à 15 h, lorsque les rayons UV sont à leur plus fort. Portez un chapeau, des vêtements et des lunettes de soleil affichant la mention « UV 400 » ou « protection UV 100 % ». Réservez l’écran solaire aux zones de votre corps qui sont exposées, soit le visage, les avant-bras et les jambes.
« De nouvelles approches pour rendre les tissus plus efficaces à bloquer les UV voient le jour constamment, indique Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au Département de chimie de l’Université Laval. On peut trouver sur le marché des vêtements protecteurs de toutes les couleurs. » Si vous n’en avez pas sous la main, ajoute-t-il, « préférez les vêtements foncés ou colorés, car les colorants dans les fibres absorbent plus efficacement les rayons ultraviolets. »
Recommandé par les dermatologues : un FPS de 30 ou plus
Les dermatologues conseillent de rechercher au minimum un facteur de protection solaire (FPS) de 30, qui convient à la plupart des gens. « Si vous avez la peau claire ou sensible au soleil, optez pour un FPS de 45 à 60 », précise le Dr Joël Claveau. Un FPS de 60 est aussi indiqué si vous avez déjà eu un cancer de la peau ou si vous prenez des médicaments photosensibilisants (antidépresseurs, antidiabétiques, médicaments contre l’acné, etc.), qui rendent l’épiderme plus vulnérable aux rayons solaires.
Le programme de protection solaire de l’Association canadienne de dermatologie (ACD) homologue certaines crèmes solaires. Les produits doivent posséder un FPS de 30 ou plus, et être peu ou non parfumés, non irritants et non comédogènes. Les fabricants doivent soumettre à l’ACD des preuves de ces différentes mentions.
Quelle est la différence entre des FPS de 30 et de 50 ?
Le FPS indique la capacité d’un écran solaire à vous protéger contre les rayons ultraviolets B (UVB), grands responsables des coups de soleil. Attention, toutefois : vous ne doublez pas le degré de protection solaire en optant pour un FPS deux fois plus élevé. Un FPS de 15 signifie qu’il vous protège contre 93 % des rayons UVB du soleil, tandis qu’un FPS de 30 en bloque 97 %. Au-delà de 30, le gain est plus modeste. La protection d’un FPS de 50 passe à 98 %, alors qu’un FPS de 60 protège à 98,3 %.
Large spectre et protection contre les UVA
Il ne faut pas oublier les rayons ultraviolets A (UVA), qui pénètrent plus profondément dans la peau – jusque dans le derme. Ils contribuent au vieillissement prématuré de la peau et sont associés, à l’instar des UVB, à une augmentation du risque de cancers cutanés. Pour obtenir une protection contre les deux types de rayons UV, recherchez un écran à large spectre, une mention règlementée par Santé Canada. Tous les produits que nous avons testés affichent celle-ci.
S’il est facile de comparer le degré de protection contre les UVB des différents produits (grâce au FPS), il n’existe pas de mesure semblable en ce qui concerne les UVA. Nos tests révèlent que, d’une marque à l’autre, la protection contre ceux-ci varie davantage que celle contre les UVB. Consultez nos résultats.
Résistant à l’eau ou à la transpiration
Les écrans solaires hydrofuges promettent une résistance à l’eau d’une durée limitée à 40 ou 80 minutes pour les jours de baignade et les activités sportives. Cette allégation doit s’appuyer sur des tests reconnus par Santé Canada.
Tous les vaporisateurs évalués par Verdict santé affichent une résistance à l’eau alléguée de 80 minutes. En revanche, la protection en bâton et trois des écrans solaires en lotion ou en crème apparaissant dans notre tableau ne prétendent pas être hydrofuges. Ils sont donc à éviter si vous prévoyez passer la journée à faire trempette.
Notez qu’aucun produit n’est complètement résistant à l’eau. La friction d’une serviette ou d’un vêtement, combinée à un séjour prolongé dans l’eau, suffit à éliminer une bonne partie de la protection. Santé Canada recommande, à l’instar des autorités américaines et européennes, d’appliquer une seconde couche d’écran solaire au maximum deux heures après la première.
Faut-il craindre les écrans chimiques ?
Deux types de filtres sont employés pour créer des écrans solaires : les chimiques, qui absorbent les rayons UV, et les physiques, aussi appelés minéraux, qui les réfléchissent. Lesquels privilégier ?
Depuis quelques années, plusieurs experts accusent les filtres chimiques de passer au travers de la peau et d’être potentiellement dangereux pour la santé. « Les preuves s’accumulent au sujet d’ingrédients, particulièrement l’oxybenzone et l’octocrylène, qui se rendent dans le plasma dans des concentrations plus élevées que ce qui était estimé autrefois », explique Normand Voyer. Des études réalisées sur des animaux ont aussi démontré que ces composés peuvent, à fortes doses, agir comme perturbateurs endocriniens, c’est-à-dire dérégler les fonctions hormonales et, soupçonne-t-on, induire des troubles de fertilité et certains cancers.
Un autre ingrédient, l’homosalate, préoccupe la communauté scientifique. De récentes études ont poussé, en 2022, la Commission européenne à abaisser la concentration maximale autorisée de cette substance à 7,34 % dans les produits cosmétiques pour le visage. Les fabricants européens ont jusqu’à 2025 pour se conformer à la nouvelle règlementation. Au Canada, l’homosalate est autorisé jusqu’à une concentration de 15 % pour tout le corps. Parmi les produits testés, un seul – LIFE BRAND Écran solaire à vaporisation continue – contient de l’homosalate à une concentration de 15 %, tandis que 12 autres en renferment de 5 à 10 %.
Les filtres chimiques constituent aussi une source de pollution des cours d’eau, et leurs répercussions sur les coraux sont toujours à l’étude. Plusieurs États insulaires, comme Hawaï et le petit archipel micronésien des Palaos, ont d’ailleurs banni l’oxybenzone. Soupçonné de rendre la lumière toxique pour les coraux, ce composé chimique est de moins en moins utilisé dans les crèmes solaires. Lors de notre test de 2020, 9 produits sur 22 en contenaient, comparativement à seulement 2 sur 14 en 2022. Dans l’édition de 2024, 3 des 23 produits que nous avons testés renferment de l’oxybenzone et 13 de l’octocrylène.
Toutefois, puisqu’il n’existe pas de preuves scientifiques que ces ingrédients entrainent des effets néfastes sur la santé humaine, rien n’indique que vous devriez craindre les écrans chimiques, conclut l’Association canadienne de dermatologie. « Des preuves scientifiques solides démontrent que l’exposition aux rayons UV est plus dommageable pour la santé que les effets négatifs hypothétiques des écrans solaires », soutient l’ACD, qui rappelle que les composés chimiques sont règlementés par Santé Canada au même titre que tout autre médicament en vente libre.
Si vous souhaitez tout de même les éviter par précaution, vous pouvez privilégier les écrans minéraux – composés de dioxyde de titane et/ou d’oxyde de zinc –, s’entendent les experts. Parmi les 23 produits que nous avons évalués, 9 sont exclusivement de ce type.
Les dermatologues invitent par ailleurs les personnes allergiques ou intolérantes aux produits chimiques à opter pour les écrans solaires minéraux, qui sont moins susceptibles de provoquer des réactions.
Le point sur les nanoparticules
Les écrans dits physiques suscitent aussi des préoccupations. Au cœur des débats : la présence de nanoparticules. En Europe, la législation se penche sur le problème de leur grosseur. « Les fabricants diminuent la taille des particules [de dioxyde de titane et d’oxyde de zinc] pour augmenter l’efficacité du filtre et, surtout, pour rendre le produit plus translucide », ce qui évite de laisser la peau blanchâtre, explique Christine Lafforgue. Par contre, des particules trop fines pourraient pénétrer dans la peau, spécialement si celle-ci est endommagée, et potentiellement s’infiltrer dans le sang.
« Les nanoparticules ont un pouvoir inflammatoire. Une fois dans l’organisme, elles sont associées à de nombreux effets indésirables sur les systèmes pulmonaire, immunitaire, cardiovasculaire et nerveux, et à certains cancers », explique l’immunologue Denis Girard, directeur du laboratoire de recherche en inflammation et physiologie des granulocytes de l’INRS – Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Il recommande de réduire autant que possible l’exposition aux nanoparticules puisqu’elles ont envahi notre quotidien. Elles sont présentes dans les emballages alimentaires, la nourriture, les textiles et les médicaments, par exemple, et pas uniquement dans les écrans solaires, dit-il.
Plusieurs études récentes ont toutefois démontré que les nanoparticules d’oxyde de zinc et de dioxyde de titane contenues dans les écrans solaires ne pénètrent pas au-delà de l’épiderme. Par conséquent, l’ACD conclut que, comme pour les ingrédients chimiques, aucune preuve ne laisse croire que les lotions qui en renferment soient toxiques. Et, pour l’instant, Santé Canada se limite à évaluer les risques liés à leur usage.
Crème minérale ou chimique : laquelle est la plus efficace ?
Les lotions minérales sont-elles aussi efficaces que les chimiques ? Cette année encore, nos tests en laboratoire montrent que des produits ne contenant que des filtres physiques peuvent offrir une très bonne protection, même si ce n’est pas toujours le cas. Même constat du côté des écrans chimiques : certains offrent une excellente protection, alors que d’autres obtiennent de moins bonnes notes. Certains écrans solaires, dont l’un apparait dans notre liste de meilleurs choix, combinent des filtres chimiques et physiques.
Crème, lotion, vaporisateur (spray) ou bâton ?
« Il vous faut un produit que vous aimez appliquer, parce que c’est plate, vous mettre de la crème solaire, et il faut en mettre souvent », explique le Dr Joël Claveau, qui ne conseille pas un type de produits plus qu’un autre. Dans le cas des formules vendues en vaporisateur, Santé Canada recommande de les utiliser dans un lieu aéré et de ne pas les pulvériser directement sur le visage, en raison du risque d’inhalation.
Quand et comment appliquer un écran solaire ?
Peu importe le type d’écran solaire, vous devez l’appliquer 15 minutes avant l’exposition, selon Santé Canada.
Les lotions ont l’avantage de vous permettre de voir où vous faites l’application. Santé Canada recommande d’utiliser environ sept cuillères à thé (35 ml) pour couvrir le corps d’un adulte, soit une par zone (visage, chaque bras et chaque jambe, le torse et le dos).
Vous devez appliquer les produits en vaporisation en tenant le contenant à une distance de 10 à 15 cm de votre peau, puis les étaler sur celle-ci. Pour en enduire votre visage, vaporisez-les préalablement dans vos mains. À noter : il vaut mieux effectuer ce petit rituel dans un endroit aéré, mais non venteux.
Peu importe l’indice de protection de l’écran solaire que vous utilisez, vous devez en réappliquer toutes les deux heures, après les baignades ou à la suite d’activités physiques intenses, car la transpiration ou le frottement des tissus, par exemple, réduisent la durée de protection.
Vous employez déjà de la crème solaire ? Mettez-en plus.
Le principal problème en ce qui concerne les écrans solaires, selon les dermatologues : vous n’en appliquez pas suffisamment. Plusieurs études ont démontré que les gens en emploient de deux à quatre fois moins que la quantité recommandée par Santé Canada (35 ml pour un adulte). Résultat : « Une personne qui utilise un FPS de 60, mais qui applique le quart de la quantité nécessaire se retrouve en réalité avec un FPS de 15 », signale le Dr Joël Claveau. Certaines parties du corps sont aussi négligées, poursuit-il ; en premier lieu les tempes, les oreilles, la nuque et le dos. C’est également le cas des lèvres. Le Dr Claveau, à l’instar de l’ACD, recommande d’utiliser un baume à lèvres doté d’une protection solaire.
Pour vérifier si vous appliquez assez d’écran solaire, rappelez-vous qu’une bouteille de 240 ml ne suffit que pour environ sept utilisations. Sur la plage ou sur le bord de la piscine, où vous en remettrez régulièrement (et après chaque baignade), vous devriez donc prévoir presque une bouteille complète par jour ! Si vous optez pour l’une des 23 crèmes solaires que nous avons testées, sachez qu’une seule application de 35 ml pourrait vous coûter de 1 $ à près de 12 $, selon le produit choisi.
Et l’après-soleil ?
Après une chaude journée d’été, une baignade dans l’océan ou quelques heures à la plage, votre peau pourrait être plus sèche qu’à l’habitude. Devriez-vous acheter un soin après-soleil, dont l’action rafraichissante et nourrissante est vantée par les fabricants ? Selon le dermatologue pédiatrique Jérôme Coulombe, ce discours est purement marketing. Son conseil : une simple crème hydratante suffit pour nourrir votre peau.
Si, malgré toutes vos précautions, vous avez tout de même pris un coup de soleil, Santé Canada recommande de cesser toute exposition, de prendre une douche ou un bain d’eau tiède (et non pas froide), de boire beaucoup de liquides pendant deux ou trois jours, et de recourir à l’ibuprofène ou à l’acétaminophène pour apaiser la douleur, si nécessaire.
Vous pouvez utiliser du gel d’aloès pour vous soulager, mais vous devriez éviter les crèmes contenant des anesthésiques (comme de la benzocaïne ou de la lidocaïne) ou emprisonnant la chaleur à l’intérieur de la peau. Certains symptômes, entre autres les signes de déshydratation (soif accrue, absence d’urine, etc.) ou d’infection cutanée (enflure, pus, etc.), devraient vous pousser à consulter un médecin.

Votre assureur est-il digne de confiance? Pourrez-vous compter sur lui e...

CHRONIQUE – L’IA est désormais partout, mais rarement visible. Au Québec...
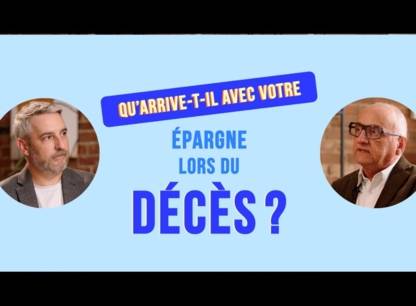
Notre journaliste rencontre André Boulais, CPA et fondateur de Boulais M...

Vous évitez la viande sans vouloir renoncer aux grillades ? Selon notre...






L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous