Imaginer un autre modèle de société, plus sobre et plus solidaire
Face à l’ampleur de la récession, la plupart des gouvernements, en Amérique et en Europe, préconisent une relance par la consommation.
Face à l’ampleur de la récession, la plupart des gouvernements, en Amérique et en Europe, préconisent une relance par la consommation. Sous la forme de bons d’achat, d’une baisse temporaire des taxes de vente ou d’une réduction des impôts directs, certains États sont même prêts à mettre la main au portefeuille et à s’appauvrir pour nous convaincre de dépenser plus.
Quitte à se priver des ressources nécessaires pour accomplir leur travail, spécialement en matière de santé et d’éducation, et à creuser encore davantage la dette publique. Cependant, même si la machine se remet en marche, même si la technologie permet de «verdir» l’économie, l’éclaircie risque fort de ne pas durer, préviennent les scientifiques et une poignée d’économistes.
La croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées est une illusion, estiment-ils. Surtout à l’heure où la pression sur les écosystèmes nous rapproche du point de rupture des équilibres écologiques. Au Québec et ailleurs, des voix s’élèvent pour appeler à sortir de la logique du «toujours plus» (plus de profits pour les spéculateurs, les actionnaires et les grands patrons, plus de biens matériels, plus d’endettement, plus de gaspillage, plus d’inégalités), responsable des désordres actuels. Et à imaginer un autre modèle de société, plus sobre et plus solidaire.
Nous en avons interrogé cinq.

Photo: Philippe Matsas / Opale
«Inventer une économie écologique»
SUSAN GEORGE est écrivaine, militante altermondialiste et cofondatrice de l’Association pour la taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens (ATTAC), présente dans 36 pays. Elle a notamment publié La pensée enchaînée (Fayard, 2007) et Un autre monde est possible si... (Fayard, 2004).
La crise que nous traversons est économique, bien sûr. Mais elle est d’abord sociale, avec l’accroissement de la pauvreté et des inégalités, et, surtout, écologique, avec le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, la contamination chimique de notre environnement, la dégradation des océans ou la question de l’eau. Elle nécessite donc un traitement multiple. Malheureusement, nos dirigeants reprennent de vieilles recettes qui ne régleront rien sur le fond. Si on parle de relancer la consommation en offrant de l’argent à ceux qui en ont besoin pour vivre décemment, d’accord. Mais le distribuer indistinctement, par la baisse des impôts par exemple, n’est pas une solution.
Doit-on réformer le système?
On a donné des milliards de fonds publics aux banques. Pourtant, elles continuent à verser des primes et des dividendes extravagants à leurs dirigeants et actionnaires et à utiliser des paradis fiscaux pour échapper à l’impôt. Tout cela est indécent! Nous sommes arrivés au bout du «modèle» économique et social actuel et il faut en inventer un autre avant la catastrophe environnementale qui menace. Par définition, le capitalisme vit dans l’éternel présent et se montre incapable d’inclure les risques futurs dans ses analyses marchandes. L’unique moyen de vivre tous ensemble dans de bonnes conditions sur cette planète, c’est d’aller vers une économie écologique.
De quelle façon?
Il faut commencer par prendre le contrôle des banques, qui doivent être au service des politiques de l’État et surtout des citoyens et des PME-PMI [petites et moyennes industries], qui fournissent pratiquement tous les emplois. Et exiger qu’elles consacrent un certain pourcentage de leurs prêts à des fins environnementales, comme la construction de bâtiments à consommation énergétique nulle, le développement d’énergies renouvelables ou la création de transports en commun «propres», le tout à des taux d’intérêt très bas. Le crédit doit devenir un bien collectif. Les gouvernements ont le devoir de préparer l’avenir, d’investir dans la santé, l’éducation. Et s’ils disent qu’il n’y a pas d’argent, il faut leur répondre: «Si, il y en a, mais vous ne le cherchez pas là où il est!»
Que pouvons-nous faire?
Nous vivons dans un monde à l’envers: en quelques semaines on a trouvé des milliers de milliards de dollars pour sauver les banques alors que, depuis plus de 30 ans, les Nations unies n’ont jamais pu obtenir les quelques milliards d’aide au développement qui suffiraient à nourrir les 900 millions d’êtres humains qui meurent de faim ou qui souffrent de malnutrition. Le système ne se moralisera pas de lui-même, il faut le réguler. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais si chacun se mobilise, dans une association ou un syndicat, par exemple, cela permettra d’établir un rapport de force avec les gouvernements et les institutions financières.

Photo: Hermance Triay
«La crise nous mènera vers un autre monde»
HERVÉ KEMPF est journaliste spécialisé dans les questions d’environnement au quotidien français Le Monde. Ses deux derniers livres, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme et Comment les riches détruisent la planète (Seuil, 2009 et 2007), ont connu un grand succès en France et au Québec. (À voir aussi: reporterre.net)
Le capitalisme va-t-il disparaître?
Cette crise marque en tout cas la fin d’un système économique uniquement axé sur l’individualisme forcené et la marchandisation généralisée des biens et des liens sociaux. C’est aussi la fin d’un modèle fondé sur une croissance matérielle qui se pensait illimitée. Plus qu’une crise, il s’agit d’une grande transformation qui nous mènera vers un autre monde.
À quoi ressemblera ce monde?
Il faut reconstruire une société où le bien commun passe avant
le profit. L’économie ne doit plus être une fin en soi, mais un outil au
service des gens. Nous devons changer de valeurs, remplacer le marché,
la croissance, la compétition et l’individualisme par la solidarité, la
coopération et l’intérêt général. Il ne s’agit pas d’aller vers un
système de planification collective ou de contrôle par l’État de toutes
nos activités, mais d’encadrer l’économie de marché et de l’écarter de
domaines comme la santé, l’éducation, la culture ou la politique
énergétique. L’entreprise à capitaux privés et avec des actionnaires
capitalistes n’est pas le seul modèle possible; celui de l’économie
coopérative, par exemple, peut lui aussi être efficace.
Comment relever le défi écologique?
La préservation de la planète passe par une meilleure répartition de la
richesse. Au cours des 30 dernières années, les inégalités ont atteint
un niveau intolérable, que ce soit dans les pays industrialisés ou
ailleurs. Or, cette inégalité a des effets très nocifs sur le plan
écologique, car le modèle culturel exhibé par l’oligarchie au pouvoir
imprègne toute la société et nous conduit au gaspillage et à une
surconsommation matérielle généralisée. Il faut sortir de ce modèle, de
même qu’il faut changer la référence au PIB [produit intérieur brut],
avec l’idée de croissance qui l’accompagne: cet indicateur ne prend pas
en compte les dégâts occasionnés par l’activité humaine sur les
écosystèmes et il est donc inadéquat.
Si chacun fait sa part, cela suffira-t-il?
Bien sûr, il est important de réduire individuellement notre
consommation matérielle et notre consommation d’énergie. Mais c’est une
fiction de croire que les choses vont changer si le système reste
orienté vers la croissance, si nous continuons à être inondés de
publicités… Il faut faire en sorte que notre effort se traduise aussi au
niveau collectif, et donc prendre de nouvelles orientations politiques.
C’est très bien de circuler à vélo, mais si le gouvernement décide de
construire une nouvelle autoroute plutôt que d’investir dans un train,
cela ne servira pas à grand-chose. Les scientifiques estiment qu’il nous
reste une dizaine d’années avant d’atteindre le point de non-retour en
matière de changement climatique. Nous avons donc peu de temps pour
réorienter notre énorme paquebot planétaire sur une voie écologique et
juste.

Photo: HEC Montréal
«Guérir l’endettement par plus d’endettement est absurde!»OMAR AKTOUF est professeur à l’École des hautes études commerciales de
Montréal et cofondateur du groupe Humanisme et gestion. Il est l’auteur,
entre autres, de Halte au gâchis: en finir avec l’économie-management à l’américaine (Liber, 2009).
Nos gouvernements sont-ils à la hauteur?
Non! Renflouer les banques pour qu’elles prêtent à des gens déjà
surendettés ou qu’elles se remettent à se prêter entre elles ne fera
qu’alimenter la bulle spéculative. La maladie économique dont nous
souffrons actuellement est l’endettement: 200 % pour l’Américain moyen,
140 % pour un Canadien. Or, on ne peut guérir l’endettement par plus
d’endettement, c’est absurde! L’attitude qui consiste à penser toujours
en termes de marchés et de profits maximums, à croire que l’argent va
faire de l’argent, à augmenter sans cesse l’offre pour pousser les gens à
la consommation en les endettant encore plus est totalement
irresponsable.
Comment devraient-ils réagir?
En distribuant des milliards de fonds publics, l’État se prive
d’une partie importante de ses ressources – l’impôt des contribuables –,
ce qui limitera sa marge de manœuvre dans les années à venir, notamment
en matière de santé et d’éducation. Il faudrait plutôt investir cet
argent dans l’économie réelle, c’est-à-dire le salariat et la création
d’emplois, la recherche d’énergies «vertes» ou la rénovation de nos
infrastructures, qui en ont grand besoin.
Vaut-il mieux consommer ou épargner?
Le problème n’est pas la consommation en soi; au contraire,
consommer doit rester l’un des moteurs de l’économie. Mais
l’hyperconsommation tue la consommation, car on finit par trop
s’endetter, par s’encombrer de choses inutiles. Nous en mesurons
aujourd’hui les conséquences, non seulement sur le niveau de notre dette
et notre très faible épargne, mais sur le reste du monde, qui ne peut
consommer autant, sans parler de l’environnement. Chacun devrait
consommer raisonnablement, pour ses besoins réels, tout en épargnant
pour, petit à petit, assainir sa situation.
Le modèle actuel est-il viable?
Il est grand temps de remettre à plat le modèle économique et
social dans lequel nous vivons. Par exemple, il faudrait interdire les
paradis fiscaux: plus on retire d’argent de l’économie réelle pour
l’entasser dans ces «paradis» réservés à une infime minorité, plus on
tue la possibilité d’avoir une finance saine. Nous en sommes rendus au
point où le montant de liquidités en circulation atteint 30 fois le PIB
de l’économie réelle mondiale! Ce n’est plus acceptable. Il faut savoir
d’où vient l’argent, où il va, comment il s’accumule. L’économie ne doit
plus dépendre de la Bourse. On trompe les gens quand on leur parle de
placements en Bourse: il ne s’agit pas de placements, mais de jeu. Comme
au casino. Et on sait bien qui gagne à tous les coups!
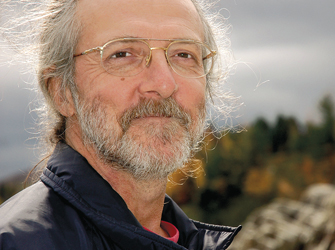
Photo: Yanik Chauvin
LOUIS CHAUVIN est président du Réseau québécois pour la simplicité volontaire et professeur de stratégie à la faculté de gestion Desautels de l’Université McGill, à Montréal.
D’où viennent nos problèmes?
La crise économique et financière, la pollution ou les changements
climatiques ne sont que des symptômes. La vraie maladie en arrière de
tout cela, c’est notre hyperconsommation. Il faut absolument sortir de
cette illusion que nous vivons dans un monde aux ressources illimitées
et trouver un système qui maintienne un niveau de vie raisonnable pour
tous, avec un meilleur partage de la richesse.
Comment y parvenir?
Tout d’abord, nous devons prendre conscience du fait que
consommer à outrance est une forme de toxicomanie. On sait aujourd’hui
que cela libère certaines substances chimiques dans le cerveau,
notamment de la dopamine, qui est extrêmement addictive. Et comme toutes
les drogues, il en faut toujours plus, parce que la sensation de
plaisir que nous éprouvons en achetant un objet est temporaire.
Résultat: nous sommes pris dans une course effrénée au plaisir,
alimentée par une publicité omniprésente. Ensuite, nous devons
comprendre pourquoi nous nous comportons ainsi; souvent, notre impulsion
à surconsommer sert à combler le vide que nous ressentons.
Faut-il arrêter de consommer?
Pour nos besoins réels, non, évidemment! En revanche, nous
devons cesser d’associer l’hyperconsommation à l’idée que nous nous
faisons du progrès, du bonheur ou du bien-être. Et ne plus confondre le
plaisir avec le bonheur. Même si cela va à contre-courant de la société
dans laquelle nous vivons, nous devons nous réapproprier le temps, faire
des activités pour nous et avec nos proches, arrêter cette course folle
pour revenir à ce qui est réellement fondamental. Autrement dit, vivre
plus simplement pour vivre mieux. Quand on parvient à mieux voir qui on
est, on devient plus solide et moins influençable par les quelque 700
milliards de dollars que les publicitaires dépensent chaque année pour
nous inciter à posséder toujours plus.
Quel avenir pour la planète?
Notre mode de vie basé sur la croissance perpétuelle, sur la
multiplication des objets et leur obsolescence planifiée n’est pas
viable. Si tous les habitants de la planète consommaient autant que
nous – et de quel droit pourrions-nous le leur refuser? –, il nous
faudrait quatre ou cinq planètes. À court ou à moyen terme, la
simplicité est donc inévitable. Reste à savoir si elle sera volontaire
ou involontaire.

Photo: Albin Michel
«Arriver à un "au-delà du capitalisme"»
GILLES DOSTALER est historien de la pensée économique et professeur à l’Université du Québec à Montréal. Spécialiste mondialement reconnu de John Maynard Keynes, l’un des économistes les plus influents du XXe siècle, il est notamment coauteur avec Bernard Maris de Capitalisme et pulsion de mort (Albin Michel, 2009).
Tout dépend de ce qu’on entend par «époque». Le modèle de croissance de l’après-guerre – hausse des salaires, gains de productivité, chômage et inflation modérés – est entré en crise dans les années 1970, notamment à la suite de l’écroulement du système monétaire international mis en place à Bretton Woods [États-Unis] en 1944. On est alors passé à une nouvelle phase, celle du «néolibéralisme», où l’intervention de l’État dans l’économie a été remise en question. D’une certaine façon, le marché est devenu une religion avec plusieurs économistes pour grands prêtres... C’est cette période-là qui est peut-être en train de s’achever. Mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la fin du capitalisme!
Peut-on «refonder le capitalisme»?
On ne peut «refonder» ce qui n’a pas été fondé, ce qui est le
résultat d’une évolution longue et complexe. La vraie question est de
savoir si nous serons capables de dépasser un système basé sur
l’accumulation indéfinie et la destruction de l’environnement.
C’est-à-dire d’arriver à un «au-delà du capitalisme» et à un véritable
développement durable, ce qui signifie le contrôle étroit de la finance
et de la banque, ainsi qu’un rôle beaucoup plus actif de l’État dans la
création de la richesse. Pour cela, il faudra engager des réformes
structurelles profondes, notamment réorganiser le système monétaire
international, instaurer un contrôle politique international des flux
financiers et des investissements et supprimer les paradis fiscaux.
Faute de quoi, les marges de manœuvre des États resteront très
restreintes et le virage vers une économie «environnementale» risque de
n’être qu’un projet capitaliste peint en vert.
L’argent a envahi notre quotidien...
L’argent est une invention utile et même indispensable pour
procéder aux échanges de marchandises. Le problème se pose lorsqu’il
devient une fin en soi. La pulsion à l’accumulation de l’argent est le
moteur du capitalisme, où tout prend la forme monétaire. Il représente aujourd’hui le mode principal d’évaluation des individus
et certains accumulent des sommes inimaginables. Il est aussi
étroitement lié à la montée de la violence sociale et du sentiment
d’insécurité. La société, à travers les pouvoirs publics, doit prendre
le contrôle de la finance et procéder à une gestion rationnelle de
l’argent, comme Keynes le proposait dès les années 1920.
Que va-t-il se passer?
Nous sommes confrontés à des problèmes sociaux et environnementaux, à des problèmes de pouvoir et de rapports de force dans nos sociétés: qui prend les décisions et en fonction de quels intérêts? La crise économique n’est pas un mécanisme naturel, mais le résultat d’une mauvaise organisation de la société. Donc, la solution ne peut être que politique. En théorie, l’humanité a les ressources et les capacités techniques pour subvenir convenablement aux besoins des populations et leur permettre de coexister de manière harmonieuse. Malheureusement, je ne suis pas certain que la volonté politique d’y parvenir existe.
10 idées pour se relever et vivre mieux
Plusieurs pistes de solution ont émergé de nos entrevues et de nos lectures. En voici un résumé.
Mettre l’économie au service de la collectivité. Ce qui implique, notamment, l’encadrement du marché par les pouvoirs publics. De même que la refonte du système monétaire international, l’harmonisation de la fiscalité sur le plan mondial et l’élimination des paradis fiscaux, qui privent les États d’une part importante de leurs recettes.
Placer la justice sociale au cœur de nos préoccupations. Revaloriser les bas salaires, instaurer un revenu maximal admissible, interdire les fonds spéculatifs, les «parachutes dorés», les bonus, les régimes d’options d’achat d’actions (stock-options), la distribution d’actions gratuites, etc.
Réduire notre empreinte écologique en développant une économie «verte» basée sur les 3R. Réduction, réutilisation et recyclage des matières premières.
Améliorer l’efficacité énergétique. De nos maisons, automobiles et appareils électriques tout en visant une économie absolue d’énergie, c’est-à-dire en réduisant notre consommation.
Donner un prix au carbone. En instaurant une taxe carbone-énergie sur l’industrie pour accélérer l’usage de techniques plus économes.
Intégrer dans le prix d’un bien ou d’un service son coût environnemental. Et exiger des fabricants que leurs produits de consommation soient plus durables et réparables.
Abandonner toute référence au PIB. Il ne mesure pas les dégâts environnementaux provoqués par nos activités et sa progression est loin d’être synonyme d’un recul de la pauvreté ou des inégalités. Les économistes travaillent déjà sur de nouveaux indicateurs prenant en considération les émissions de CO2, la biodiversité, l’empreinte écologique ou la qualité de vie.
Revoir notre «modèle» d’étalement urbain. À l’origine d’un fantastique gaspillage d’argent, d’énergie et de temps. Par exemple, en limitant la spéculation foncière, en redensifiant les villes et en développant les transports en commun.
Exiger plus des constructeurs d’automobiles. Qu’ils produisent des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables.
Cesser de produire des agrocarburants. Ils requièrent une quantité phénoménale d’eau et sont en grande partie responsables de la crise alimentaire mondiale.
Pour en savoir plus
Pour sauver la planète, sortez du capitalisme - Hervé Kempf, Seuil 2009.
Capitalisme et pulsion de mort - Gilles Dostaler et Bernard Maris, Albin Michel, 2009.
Halte au gâchis: en finir avec l’économie-management à l’américaine - Omar Aktouf, Liber, 2009.
Right Relationship: Building a Whole Earth Economy - Peter G. Brown et Geoffrey Garver, Berrett-Koehler, 2009.
Comment les riches détruisent la planète - Hervé Kempf, Seuil, 2007.
La pensée enchaînée - Susan George, Fayard, 2007.
Un autre monde: contre le fanatisme du marché - Joseph Stiglitz, Fayard, 2006.
simplicitevolontaire.org
et reporterre.net









L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.