Comment va la santé des hommes?
Si les problèmes cardiaques, le suicide et certains cancers continuent d’affecter plus d’hommes que de femmes, les campagnes de prévention et de sensibilisation ainsi que les avancées scientifiques des dernières décennies portent leurs fruits. Mais il reste du travail à accomplir et des préjugés à déconstruire.
Santé négligée, mortalité plus élevée
Cancer de la prostate : une diminution encourageante
Cancer colorectal et de la vessie : les hommes surreprésentés
Attention aux maladies du cœur
Encore trop de morts par suicide chez les hommes
La recherche ayant longtemps pris les hommes comme étalon de référence, on pourrait croire qu’ils seraient en meilleure santé et qu’ils vivraient plus vieux que les femmes. Or, ce n’est pas le cas.
Toutes maladies confondues (si l’on exclut les blessures traumatiques), les données montrent que la population féminine a davantage de problèmes de santé que la gent masculine, note Gilles Tremblay, professeur retraité de l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval. « Mais quand on regarde qui en meurt, il y a plus d’hommes. »
Les campagnes de sensibilisation et de financement, comme celles que mène le mouvement Movember, lancé en Australie en 2003, peuvent-elles y remédier ? D’abord axé sur la prévention et le traitement du cancer de la prostate, Movember se soucie maintenant du cancer testiculaire, de la santé mentale et de la prévention du suicide chez les hommes. « Ce qui est intéressant avec ces campagnes, c’est qu’elles s’adressent aux hommes ; ça devient in de se préoccuper de sa santé », avance Gilles Tremblay.
Hormis des investissements importants dans la recherche (plus de 300 millions $ en 20 ans à l’échelle mondiale), il reste toutefois difficile de mesurer les impacts réels de Movember : la revue britannique scientifique The Lancet soulève que le mouvement cible sans doute mal la population concernée, puisque « les hommes à risque de cancer de la prostate sont généralement plus âgés que ceux de la génération qui se laisse pousser la moustache en réponse à Movember ».
Santé négligée, mortalité plus élevée
Les hommes sont-ils surreprésentés parce qu’on s’intéresse peu à eux, ou le problème se trouve-t-il ailleurs ? « Ce qui est assez frappant, c’est que les hommes attendent pour demander de l’aide. Les choses s’améliorent, mais il y a encore de grands pas à faire », observe Gilles Tremblay.
N’empêche, ils consultent généralement moins les services de santé que les femmes (70 % comparativement à 85 %). Selon Statistique Canada, le taux de mortalité liée à de mauvaises habitudes de vie (tabagisme, surconsommation d’alcool, alimentation malsaine) est, au Québec, deux fois plus élevé chez eux que chez les femmes (154,5 cas contre 82,1 par 100 000 individus).
Cancer de la prostate : une diminution encourageante
Le cancer reste la principale cause de décès chez les Québécois, mais les hommes en meurent plus que les femmes, selon Statistique Canada (215,7 décès par 100 000 individus contre 168,3 chez les femmes en 2022). Les cancers du poumon, colorectal et de la prostate sont les trois plus mortels chez les hommes, indique la Société canadienne du cancer.
Même si l’espérance de vie masculine continue d’augmenter (et avec elle, les risques de développer un cancer), les campagnes de sensibilisation et les avancées scientifiques ont amélioré le pronostic de certains cancers, notamment celui du cancer de la prostate. Depuis 1993, « il y a eu énormément de progrès », se réjouit le Dr Yves Fradet, clinicien-chercheur en urooncologie au Centre de recherche du CHU de Québec. Ainsi, le test de l’antigène prostatique spécifique (APS) permet de mesurer, à partir d’un simple échantillon sanguin, la concentration d’une protéine produite par la prostate. Un taux élevé peut indiquer la présence d’un cancer. Les patients à risque sont ensuite soumis à un examen par résonance magnétique.
Fini le recours systématique à des méthodes traumatiques comme l’échographie transrectale (introduction d’une sonde par le rectum) et la biopsie de la prostate (prélèvement de tissus prostatiques). « Ce n’était pas simple ; il y avait une certaine douleur et de petits risques de complications », précise le Dr Fradet. Ces tests détectaient les cancers précoces, qu’on traitait systématiquement. « Mais on a compris que certains cancers évoluent très lentement, et qu’on peut suivre ces patients sans traitement et n’intervenir que si la maladie se développe. »
Les traitements ont aussi grandement évolué. « Depuis 10 ans, l’hormonothérapie a beaucoup prolongé la survie, et c’est sans compter l’arrivée d’autres nouvelles thérapies », affirme le Dr Fradet. Cette méthode, qui réduit le taux d’androgène, une hormone mâle qui stimule la croissance des cellules cancéreuses, est combinée avec d’autres médicaments et traitements.
Cancer colorectal et de la vessie : les hommes surreprésentés
L’incidence du cancer de la vessie chez les hommes, elle, n’a pas diminué. « Ce n’est pas un cancer typiquement masculin, mais il est trois fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, constate le Dr Fradet. On pensait que les hommes étaient surreprésentés parce qu’ils fumaient ou qu’ils travaillaient dans des usines, mais ça se maintient dans les différentes populations partout dans le monde. Il y a surement une composante génétique. » On soupçonne que les hormones mâles jouent un rôle dans l’incidence de la maladie et la réaction aux traitements.
Les cancers colorectal et pulmonaire touchent aussi disproportionnellement les hommes, même si le taux de mortalité attribuable à ces deux maladies a chuté entre 1985 et 2010. Comme pour le cancer de la prostate, un nouveau test sanguin permet de cibler les patients qui risquent de développer un cancer colorectal, ce qui pourrait améliorer les pronostics.
Attention aux maladies du cœur
Les maladies du cœur restent parmi les causes importantes de décès chez les deux sexes, mais touchent davantage les hommes. La prévalence est d’ailleurs plus élevée dans certains métiers traditionnellement masculins, comme la construction et la prévention des incendies. « Par contre, après la ménopause, les femmes “rattrapent” les hommes, et l’incidence des maladies du cœur est semblable », indique le Dr Philippe L.-L’Allier, cardiologue hémodynamicien et directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal. Jusqu’à la ménopause, les hormones joueraient un rôle protecteur chez les femmes.
Et les perspectives ne sont pas des plus réjouissantes, indique le Dr L.-L’Allier. Après avoir observé, pendant plusieurs années, une amélioration de la santé cardiovasculaire en général, on voit que la courbe s’aplatit. « Et on croit que ça va empirer, comme c’est le cas aux États-Unis. » En effet, de nouveaux facteurs de risque (pollution, aliments ultratransformés, changements climatiques, obésité, etc.) sont apparus, même si d’autres s’atténuent (comme le tabagisme).
Pourtant, des avancées ont eu lieu. « On a beaucoup d’outils technologiques, de ressources et d’expertise. Mais le problème, c’est quand les gens ne viennent pas chercher les soins », insiste le Dr L.-L’Allier, qui rappelle que consulter rapidement réduit les dommages.
« Les [jeunes] hommes ont plus souvent le sentiment d’être invincibles et ont moins l’intérêt de consulter pour un problème de santé. Ils vont se convaincre qu’ils ont une indigestion ou un autre problème bénin, et vont attendre plusieurs semaines avant de consulter. » Il est donc primordial de reconnaitre les symptômes d’une crise cardiaque (douleurs thoraciques, essoufflement, perte de connaissance, douleur dans le bras gauche, douleur à la mâchoire).
Du côté de la prévention, la recette est connue, rappelle le Dr L.-L’Allier : bien dormir, avoir un poids santé, faire 30 minutes d’exercice par jour, bien manger, ne pas fumer.
Encore trop de morts par suicide chez les hommes
Il faut aussi se préoccuper de la santé mentale masculine. En effet, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y aurait trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Le taux le plus élevé s’observe chez ceux de 50 à 64 ans.
Heureusement, le portrait s’améliore depuis les années 1990, période où le Québec connaissait ses plus hauts taux de suicide : chez les hommes, le sommet a été atteint en 1999 (35,8 cas par 100 000, comparativement à 9,1 femmes). « À l’époque, on entendait que le Québec avait le plus haut taux de suicide au monde », se souvient l’épidémiologiste Pascale Lévesque, chargée de la surveillance du suicide à l’INSPQ.
Grâce à de nombreuses actions (stratégie ministérielle, campagnes de prévention, restriction de l’accès aux moyens), le taux de suicide est en baisse depuis deux décennies : il est passé de 22,1 à 12,7 par 100 000 personnes entre 1999 et 2022. On a aussi déployé des stratégies ciblées auprès de populations vulnérables (la communauté LGBTQ, par exemple). « Mais depuis deux ans, on a un plancher. On dirait que les mesures ne sont pas adaptées aux nouveaux facteurs de risque, comme la montée des médias sociaux », soulève Pascale Lévesque.
Paradoxalement, on recense plus de tentatives de suicide et d’hospitalisations chez les femmes. « Elles utilisent des moyens moins létaux. On sait également que les femmes vont davantage en parler et aller chercher de l’aide. »
Si on a sous-détecté pendant des années les crises cardiaques chez les femmes parce qu’on en reconnaissait mal les symptômes, ce sont désormais les indices de la détresse masculine qui passent sous le radar, dit Gilles Tremblay. « Il faut sensibiliser le personnel de soins et l’entourage à être attentifs à ces signes. » La dépression reste ainsi un trouble sous-diagnostiqué chez les hommes, qui ont moins tendance que les femmes à rapporter anxiété, détresse psychologique et autres problèmes de santé mentale.
Différentes initiatives ciblées peuvent être mises en place dans les milieux de travail à prédominance masculine. Par exemple le déploiement d’une campagne dans des lieux fréquentés par les hommes, des mesures d’accompagnement lors de la fermeture d’une entreprise ou l’organisation d’ateliers d’information sur l’heure du diner. Cette approche serait bénéfique pour détecter d’autres problèmes de santé qui touchent les hommes de façon disproportionnée.
Pour que les hommes puissent vivre plus longtemps et en meilleure santé, il est temps de changer leur attitude et leurs habitudes, conclut le Dr L.-L’Allier. « C’est à leur tour de s’occuper de leur santé et d’y réfléchir. »
Si vous avez besoin d’aide et de parler, vous pouvez contacter le 988, le numéro canadien pour prévenir le suicide.

Vous aimez l’ambiance des terrains de camping et vous songez à devenir u...
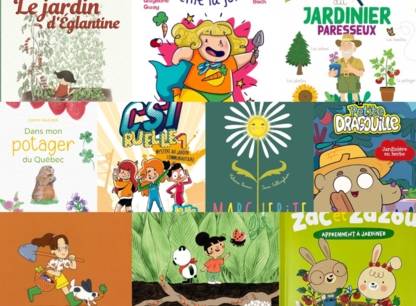
À l’approche de la saison des potagers, Protégez-Vous, en collaboration...

Résidence familiale, voiture, héritage : depuis le 30 juin 2025, la donn...

En effervescence au début de la décennie, l’industrie du vélo à assistan...






L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.