Bac de récupération: un Québécois sur deux se trompe
Un sondage montre que 55 % des citoyens sont confus quand vient le temps de remplir le bac de recyclage. Ils ne savent pas exactement quelles matières y mettre.
Jouets, toiles de piscine, grille-pain, boyaux d’arrosage et autres lumières de Noël finissent souvent dans le bac de recyclage, alors qu’ils n’ont rien à y faire. À tel point qu’ils représentent aujourd’hui 15 % de son contenu, soit trois fois plus qu’en 2010.
Le traitement de ces objets entraîne chaque année des coûts supplémentaires de plus de 20 millions de dollars, selon Éco Entreprises Québec (ÉEQ), un organisme privé sans but lucratif agréé par le gouvernement. Il représente plus de 3 000 entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés.
Idées reçues
Pour mieux évaluer le problème, ÉEQ a fait réaliser un sondage sur la perception qu’ont les citoyens de la collecte sélective.
Publiée le 6 août, cette enquête, menée par la firme Léger Marketing, confirme que, malgré de bonnes habitudes de récupération, certaines idées reçues ont la vie dure.
Ainsi, beaucoup de Québécois croient, à tort, que les jouets en plastique (55 %), les plats en pyrex (47 %), les contenants en bois pour les clémentines (41 %), les boyaux d’arrosage (23 %) ou les grille-pain en métal (19 %) vont dans le bac de récupération.
Pas un fourre-tout…
Selon ÉEQ, cette confusion est liée à une mauvaise compréhension de ce qu’est une matière recyclable. «Les résultats du sondage démontrent que le geste du citoyen est basé sur un tri par matière (plastique, papier, carton, métal, verre) plutôt que sur ce qui est réellement visé par la collecte sélective, à savoir les contenants, les emballages et les imprimés», explique Maryse Vermette, présidente-directrice générale d’ÉEQ.
La solution? «Les municipalités et RECYC-QUÉBEC doivent mieux informer et sensibiliser la population sur les matières qu’on peut mettre dans le bac de recyclage», indique-t-elle. Quelque 78 % des citoyens estiment que la sensibilisation à ce qui y va ou pas incombe aux instances municipales ou gouvernementales.
Querelle entre entreprises et municipalités
Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), croit lui aussi que le moyen le plus efficace de réduire le volume de matières indésirables dans les bacs de recyclage est de mieux informer les citoyens. Mais il estime que les villes manquent de moyens pour y parvenir.
«L’argent de l’industrie ne permet pas de payer les bacs ni les initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation du public, explique-t-il. En fin de compte, on se retrouve avec un écart de 65 millions de dollars entre ce qui est versé par ÉEQ et ce que coûte réellement la collecte sélective. La collecte est donc assumée par les citoyens, alors qu’elle devrait être prise en charge par les entreprises.»
Maryse Vermette, qui n’est pas de cet avis, souligne qu’en vertu de «l’un des cadres réglementaires les plus exigeants en Amérique du Nord, les entreprises québécoises qui fabriquent des contenants, des emballages et des imprimés assument désormais 100 % des coûts nets de la collecte sélective, du transport, du tri et du conditionnement des matières recueillies, ce qui représente plus de 100 millions de dollars chaque année».
Qui doit payer?
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs s’apprête à adopter un projet de règlement prévoyant que les municipalités et les entreprises partageront à parts égales les dépenses associées à la gestion des «matières orphelines». ÉEQ a d’ores et déjà annoncé que les entreprises refusaient «catégoriquement» un tel scénario, estimant que ces coûts devaient être entièrement assumés par les municipalités, «puisque celles-ci sont responsables de la collecte sélective». Quant à l’information du public et à l’achat de bacs de récupération, il s’agit d’une affaire purement municipale, juge Maryse Vermette, qui croit que l’industrie n’a pas à s’en mêler.
Bac de récupération: ce qui n’y va pas
- Huiles et peintures;
- Ampoules fluo compactes et tubes fluorescents;
- Piles;
- Appareils électroniques (ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, téléphones cellulaires ou traditionnels, etc.);
- Accessoires pour produits informatiques (disques durs, cartes mémoires, routeurs, serveurs, clés USB, etc.).
Pour tous ces produits, qui ont un fort potentiel de toxicité, il existe plus de 3 000 points de collecte et de dépôt dans la province, gérés par des organismes reconnus par RECYC-QUÉBEC.
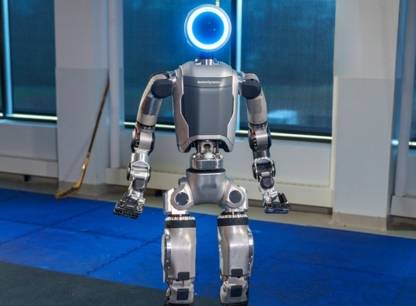
Cette semaine s’est tenue la 59e édition du Consumer Electronics Show (C...

Ticketmaster pourrait devoir indemniser à nouveau des consommateurs québ...

Amazon, le géant du web américain, représente l’entreprise qui a fait l’...

L’année qui s’achève a été marquée par une avancée en droit de la famill...






L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous