Enquête: la vérité sur les «crédits» carbone
La compensation carbone est plus accessible qu’avant, mais son fonctionnement demeure complexe. Notre analyse montre que, parmi les programmes bien d’ici, un seul compense vraiment votre empreinte carbone. Et que vous ne pourrez sans doute jamais vous vanter d’être «carboneutre».
Avant de sortir votre portefeuille pour compenser les émissions de CO2 que vous produisez, choisissez un fournisseur qui vous permettra de compenser pour de vrai.
Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous avons comparé ces 11 fournisseurs: Planetair, Carbone boréal, Ecotierra, Solutions Will, Arbres Canada, Socodevi, Arbre-Évolution, Bourse du carbone Scol’ERE, LessEmissions, Compensation CO2 Québec et EnRacine/Taking Root.
Par ailleurs, plusieurs outils en ligne peuvent vous aider à calculer la quantité de CO2 que vous produisez, mais tous ne sont pas aussi complets et fiables qu’ils le prétendent. Pour savoir qui dit vrai, nous avons évalué neuf d'entre eux et nous avons identifié les meilleurs.
Certes, compenser vos émissions de GES constitue un pas dans la bonne direction, mais vous devez aussi changer vos habitudes de consommation pour espérer sauver la planète. Nous vous expliquons pourquoi.
L’idée de compenser les émissions de CO2 que vous produisez en vous déplaçant en auto ou en avion vous interpelle. Avant de sortir votre portefeuille, consultez notre comparatif afin de choisir un fournisseur qui vous permettra de compenser pour de vrai. Nous avons évalué 11 d'entre eux: Planetair, LessEmissions, Carbone boréal, Ecotierra, Compensation CO2 Québec, Arbres Canada et plusieurs autres.
Plusieurs outils en ligne peuvent vous aider à calculer la quantité de CO2 que vous produisez, mais tous ne sont pas aussi complets et fiables qu’ils le prétendent. Pour savoir qui dit vrai, nous avons évalué ceux-ci: calculcarbone.org, Arbres Canada, Carbone boréal, Compensation CO2 Québec, Less Emissions, NatureLab.World, Planetair, Socodevi et EnRacine/Taking Root.
Sans être LE remède qui sauvera la planète, la compensation carbone constitue un outil facile à utiliser pour minimiser votre empreinte environnementale et progresser dans la transition écologique. À condition de l’utiliser intelligemment et pas juste pour vous sentir moins coupable de voyager en avion ou de conduire une voiture. Survol des pour et des contre de cette offre de service hors du commun.
Notre grand dossier « La vérité sur les crédits carbone » a suscité de vives réactions de la part de dirigeants d’organismes dont les programmes étaient évalués.
Il faut savoir que, pour être en mesure d’analyser leurs programmes, nous avions demandé à ces organismes de soumettre de nombreux documents, ce qui a exigé du travail de leur côté. Nous avons ensuite tout décortiqué pour retenir les données nous permettant de comparer les programmes sur des bases communes.
Or, nos critères d’évaluation peuvent sembler bien froids et cliniques pour des professionnels s’étant investis corps et âme, pendant des années, à mettre sur pied et en marché des programmes complexes et basés sur des valeurs comme la coopération et l’engagement social. Nous reproduisons donc ci-dessous le texte intégral des répliques qu’ils nous ont fait parvenir en l’accompagnant d’une réponse détaillée qui remet le tout dans le contexte de la mission de Protégez-Vous.
Les répliques des dirigeants des programmes
Vous avez donné la note « acceptable » pour le critère de permanence des compensations de Carbone boréal. Cette note est injustifiée.
Notre gestion dynamique permet la permanence des stocks de carbone attribués pour compenser les émissions, et non pas la permanence des arbres. En ayant des tampons, si un arbre est détruit, le carbone attribué est transféré à un autre. La séquestration est donc irréversible pour la quantité de CO2 compensée qui est soustraite de l’atmosphère de manière additionnelle. Ce qui est unique et encore plus permanent que les projets d’énergie renouvelable, car rien ne garantit qu’ils remplacent des centrales fossiles existantes. Dans la majorité des cas, les projets d’énergie renouvelable s’ajoutent au parc existant et ne font que diminuer l’intensité carbonique au niveau national.
Le nouveau kWh [kilowattheure] est carboneutre de façon irréversible, d’accord, mais il ne diminue pas la quantité de CO2 qui continue de s’accumuler dans l’atmosphère. Quant aux projets d’efficacité énergétique, en vertu du paradoxe de Jevons, rien n’assure que les gains ne [sont] pas déplacés par l’augmentation de la demande. La preuve en est que malgré les efforts importants réalisés dans ce domaine et dans l’énergie renouvelable, les émissions continuent d’augmenter à l’échelle planétaire.
Donc ces projets réduisent l’intensité carbonique, alors que les projets de plantation créent des puits de carbone. Cela contribue à réduire en proportion la quantité de CO2 qui s’accumule dans l’atmosphère en le transférant dans un autre compartiment. Une seule forme de projet crée une permanence plus grande que celle de Carbone boréal : ce sont les projets de séquestration géologique d’émissions provenant de la biomasse, ou encore de captage géologique de CO2 atmosphérique avec minéralisation. En donnant la note « acceptable », vous n’avez pas tenu compte de ces faits.
Lorsque, en éditorial, vous affirmez qu’un seul fournisseur peut répondre à tous les critères, c’est faux.
Claude Villeneuve, professeur titulaire
Directeur de l’infrastructure de recherche Carbone boréal
Département des sciences fondamentales Université du Québec à Chicoutimi
Des arbres pour lutter contre la pauvreté et les changements climatiques : voilà la mission de l’Arbre de l’intercoopération. Ce programme de compensation carbone volontaire a été mis sur pied par la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), une organisation sans but lucratif reconnue internationalement et auditée de manière indépendante chaque année. Depuis 2009, 179 788 arbres ont été plantés par des coopératives au Guatemala, au Pérou et au Québec grâce à l’engagement de SOCODEVI, mais surtout grâce à la volonté d’entreprises et d’organisations du milieu coopératif québécois de compenser les émissions de carbone liées à leurs activités.
Ces dizaines de milliers d’arbres n’auraient jamais vu le jour sans notre programme. Ce dernier diffère des autres par son accent sur l’intercoopération et par son souci d’améliorer les conditions de vie des populations des pays en développement. Sa rigueur méthodologique repose sur un protocole détaillé basé sur les meilleures pratiques dans le domaine. Ce protocole fait partie intégrante des ententes que les partenaires s’engagent à respecter, allant des critères d’admissibilité des sites à la conservation des arbres. Afin d’assurer que le carbone compensé [est] piégé, 20 % des arbres plantés servent spécifiquement à pallier les risques d’inversion encourus par l’utilisation de matériel vivant. Les plantations sont géoréférencées et suivies minutieusement par des spécialistes sur le terrain qui tiennent des rapports à jour.
Les arbres plantés contribuent soit au boisement, soit à la diversification des parcelles agroforestières des familles dans les pays en développement. À la fin de leur durée de vie utile, les arbres plantés sont transformés de manière responsable pour engendrer des revenus considérablement plus élevés pour les familles et les coopératives, puis un nouveau cycle peut recommencer.
Renforcer durablement les coopératives et améliorer les conditions de vie de leurs membres, c’est la raison d’être de SOCODEVI depuis 1985.
Jean-Philippe Marcoux,
directeur général
SOCODEVI
En guise de réplique, Arbre-Évolution vous présente une citation de Jean Nolet, président de Coop Carbone, une des organisations les plus crédibles au Québec en matière de solutions compensatoires.
« Même si j’ai apprécié la mise en contexte, le narratif et les explications données sur les diverses facettes du marché dans l’enquête de Protégez-Vous, je dois admettre qu’après la lecture, je ressors troublé par le bulletin comparatif qui est présenté.
Il faut admettre que c’était un exercice de comparaison difficile, car on traite d’un marché volontaire où les acheteurs achètent un crédit en se basant sur ce qui compte le plus pour eux. Ainsi, on a des joueurs qui vendent des crédits associés à des projets communautaires locaux, à des projets éducatifs, au développement international, à des plantations d’arbres. Certains ne font que les acheter et les revendre; d’autres sont très actifs sur le terrain. Certains sont des OBNL; d’autres sont des entreprises privées. Pas facile de s’y retrouver. Néanmoins, en regardant la note attribuée à Arbre-Évolution, j’ai eu l’impression que la tête des Robin des Bois avait été mise à prix.
À mon avis, il n’y a pas plus pur, idéaliste et incorruptible que ce groupe de personnes que constitue Arbre-Évolution. Cette coopérative de solidarité vend de vrais crédits additionnels qui résultent de projets de reboisement communautaires. Elle mobilise les gens, améliore leur environnement et génère pour nos milieux de vie des retombées positives à la tonne. Son équipe refuse tout compromis susceptible de faire place au greenwashing. Elle redistribue le profit dans des projets éducatifs comme www.lesemoir.org et paie des salaires modestes à ses membres pour dégager le plus de ressources possible là où ça compte. La transparence d’Arbre-Évolution est impeccable et l’information disponible sur le [site] www.arbre-evolution.org en témoigne.
Comment peuvent-ils se classer derniers dans ce palmarès, alors qu’ils pourraient sans doute y
figurer premiers ? »
Jean Nolet,
président
Coop Carbone
[NDLR : Arbre-Évolution est membre de la Coop Carbone. Sollicitée par Arbre-Évolution en 2017, la Coop Carbone a évalué le modèle de séquestration de cet organisme et vérifié la structure de suivi de projets qu’il utilise pour travailler dans le marché du carbone. Des ajustements et améliorations ont été demandés à Arbre-Évolution avant que Coop Carbone émette, en 2018, une validation officielle du programme.]
Arbres Canada tient à clarifier la critique adressée par Protégez-Vous concernant l’utilisation de notre propre protocole de plantation d’arbres plutôt que celui de Gold Standard. Il est important de noter que le protocole d’Arbres Canada offre les mêmes garanties et le même suivi que celui de Gold Standard. Nos critères de plantation respectent des normes élevées afin de garantir la survie des arbres, et cela n’entame en rien la qualité de nos produits et de notre service. La principale différence entre les deux protocoles réside dans la période de temps nécessaire pour atteindre un objectif de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le protocole d’Arbres Canada offre une échéance à 30 ans pour atteindre un objectif de compensation des GES en plantant davantage d’arbres que le protocole de Gold Standard, qui prévoit atteindre son objectif de compensation des GES en 50 ans. En substance, la différence se situe dans le nombre d’arbres nécessaire pour atteindre chaque objectif de compensation des GES. Il convient toutefois de garder clairement à l’esprit que les mécanismes de suivi et les garanties sont les mêmes que Gold Standard.
Cristiane Doherty, gestionnaire de marketing et de communications
Arbres Canada
Solutions Will a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l’accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME et OBNL québécoises, et retourner le plus d’argent possible à ces partenaires [à la suite de] la vente des crédits de carbone par Will.
Will n’est donc pas un simple vendeur ou un courtier de crédits de carbone. Il assume tout le risque et partage les bénéfices de la vente de ses crédits de carbone.
Ceux-ci sont-ils garantis et uniques ? Pour s’en assurer, nous avons décidé dès le départ de mettre en place un double garde-fou. Le premier concerne l’acceptation ou non des projets de réduction d’émissions de GES que nos partenaires réalisent dans le domaine de l’énergie et des déchets. Ces projets doivent être compatibles avec la méthodologie VM0018 et la vision sociale de Will. La moitié de ceux-ci ne sont pas acceptés, parce qu’ils ne répondent pas aux exigences d’additionnalité et ne peuvent être audités selon les critères rigoureux de Will.
Le second est fourni par l’adhésion du projet de Will au programme appelé VCS. Celui-ci contraint Will à un deuxième audit externe, qui est réalisé et approuvé par une tierce partie reconnue par le programme VCS, selon la norme ISO en vigueur.
Les crédits de carbone de Will sont-ils vendus une seule fois ? Oui ! Les crédits et les ventes de crédits sont enregistrés chez un registraire reconnu par l’organisme VERRA garantissant l’unicité à la fois des crédits et des transactions réalisées. VERRA maintient sur son registre toute la documentation concernant ceux-ci.
L’objectif principal est de promouvoir une économie locale tournée vers les enjeux environnementaux et d’accélérer la transition climatique, énergétique et écologique sur le territoire québécois.
Martin Clermont, président
Les Solutions Will
Développeur de la Bourse du carbone Scol’ERE (Scol’ERE), la Coop FA est heureuse de présenter des précisions sur les Crédits carbone éducatifs (CCÉ) générés par un programme scolaire dans les écoles du Québec et où l’ensemble des revenus de vente des CCÉ sont réinvestis dans ce dernier.
• Certifications et protocoles reconnus : première [solution de rechange] de compensation par l’éducation et le changement de comportement, les CCÉ de Scol’ERE sont issus d’une démarche reconnue par un comité-conseil piloté par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Il s’agit d’une évaluation indépendante menée par des experts de tous les milieux, dont celui de la compensation carbone. Pour plus de détails : Rigueur et efficacité (boursescolere.com/a-propos/les-cce/).
• Permanence : Scol’ERE a mis en place plusieurs mécanismes de garantie et de contrôle, comme des analyses de changements de comportement post-projet auprès des jeunes avec leur famille pour valider la durée dans le temps des engagements et une quantification prudente des émissions de GES évitées par les nouvelles habitudes de vie écoresponsables. Pour plus de détails : L’ABC de Scol’ERE.
• Additionnalité : en tout début de projet, Scol’ERE analyse les habitudes de vie des jeunes avec leur famille grâce à une enquête menée sur le portail web. Ce portrait de référence permet plus tard de valider que l’habitude de vie adoptée dans le cadre du projet est nouvelle et a été acquise grâce au programme éducatif.
• Éducation du public : Scol’ERE propose des enquêtes et des défis écoresponsables, des vidéos dynamiques, un compteur de GES évités, etc. dans la zone « Je m’engage ». [Une] zone autant pour les jeunes que pour le grand public, permettant de stimuler l’envie de passer à l’action.
Enfin, Scol’ERE propose un calculateur en ligne (élaboré par le CIRAIG) afin de quantifier vos émissions de GES liées aux transports. Sur demande, un calculateur format Excel pour l’énergie est aussi disponible.
Charles-Hugo Maziade, directeur
Bourse du carbone Scol’ERE
La réponse de Protégez-Vous
À l’origine de chacune des enquêtes de Protégez-Vous, il y a une question liée aux préoccupations exprimées par de nombreux consommateurs. Certaines de ces interrogations peuvent déranger. N’empêche, si elles sont assez fortes et importantes pour retenir l’attention de notre équipe, nous les traitons dans le détail et avec la plus grande rigueur.
Dans les cas du dossier « La vérité sur les crédits carbone », nous avons voulu vérifier quels programmes de compensation garantissent le mieux à leurs clients que chaque dollar dépensé contribue effectivement à compenser l’impact écologique de leurs activités.
Pour plusieurs intervenants, la question se poserait autrement. Ainsi, Jean Nolet, de Coop Carbone, nous écrit que « [dans ce] marché volontaire […], les acheteurs achètent un crédit en se basant sur ce qui compte le plus pour eux. » C’est bien vrai : vous êtes libre de choisir le programme qui correspond le mieux à vos valeurs. Vous pourriez accorder plus d’importance aux retombées positives de votre contribution financière qu’au nombre exact de tonnes de gaz à effet de serre qu’elle servira à compenser.
Une fois que vous franchissez ce pas, toutefois, ce n’est peut-être plus tout à fait une compensation carbone que vous achetez.
Pour Protégez-Vous, dont la mission consiste à informer, éduquer et accompagner les consommateurs, comparer la valeur réelle des « crédits carbone » s’est avéré crucial. Si vous payez 25, 35 ou 50 $ pour qu’une tonne de vos émissions de gaz à effet de serre (GES) n’ait pas d’effet négatif sur l’atmosphère, il est légitime de vouloir être certain que cela va vraiment se produire. Vous devez également être en situation de comprendre et de comparer les offres des fournisseurs de compensation.
D’ailleurs, nous sentons que plusieurs d’entre vous commencent à songer à compenser. Les commentaires reçus au cours des deux dernières années montrent des réflexions poussées au sujet de la consommation dans le contexte des changements climatiques.
Alors que cet intérêt s’installe dans la population, certaines initiatives deviennent plus visibles. Par exemple, l’automne dernier, au Centre Bell, on pouvait lire sur les grands écrans que dans le cadre de son programme Vert le but !, l’organisation des Canadiens de Montréal investit dans la plantation d’arbres chaque fois qu’un joueur brise son bâton. Le site d’Air Canada, lui, présente son programme Laisser moins, dont l’un des multiples volets consiste à faire planter des arbres par ses employés.
Ce type de messages, que l’on remarque de plus en plus fréquemment, amène les consommateurs à se questionner sur ce qu’ils peuvent faire pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. L’idée d’acheter soi-même des « crédits carbone » pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) n’est pas bien loin. Or, le principe même de compensation carbone prête à discussion. Compenser ne doit pas être présenté comme la solution à tous les problèmes climatiques. Avant même d’envisager de compenser, il est important de mettre en œuvre des gestes concrets pour réduire au maximum les émissions de carbone.
Une fois ces gestes posés, planter des arbres peut sembler la solution la plus évidente et la plus logique qui soit, mais plusieurs consommateurs sont perplexes à ce sujet depuis qu’une grande enquête de La Presse a révélé les failles du programme NatureLab.World. Alors, à qui faire confiance ? Pouvez-vous vraiment compenser vos émissions de GES ?
Volontaire, mais redevable
Les intervenants le disent et le répètent : nous sommes ici devant un marché dit « volontaire » (par opposition au marché réglementé obligatoire pour les grands pollueurs). Il est très peu encadré et repose d’un côté sur le développement de projets par les fournisseurs et, de l’autre, sur la volonté des consommateurs de compenser leurs émissions. Un grand nombre d’initiatives innovantes ont vu le jour ces dernières années, mais de l’avis de nombreux experts, il n’est pas évident pour les consommateurs de s’orienter vers des projets robustes. Et ces derniers peuvent être amenés à évoluer au fil du temps.
Le sérieux des organismes qui vendent des compensations carbone aux particuliers – et notamment de ceux qui ont tenu à répliquer à notre dossier – ne fait pas de doute. Malgré cela, évaluer leurs programmes nécessitait de revenir aux grands critères reconnus mondialement comme les plus cruciaux pour garantir qu’une compensation compense vraiment… ce qu’on vous dit qu’elle va compenser.
Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, l’offre de compensation doit « minimalement respecter les principaux critères exigés : les réductions d’émissions de GES doivent être additionnelles, réelles, vérifiables et permanentes ». En s’assurant qu’elles sont réelles et vérifiables, on garantit aussi qu’elles sont uniques, puisque chaque compensation vendue doit être répertoriée et clairement associée à son acheteur. En France, l’Agence de la transition écologique (anciennement Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) utilise ces mêmes critères.
L’équipe de Protégez-Vous a donc déterminé quatre critères principaux (additionnalité; permanence; achat unique; et validation et vérification des opérations), qui valaient chacun 20 % de la note globale dans notre tableau. Deux critères complémentaires (éducation du public et transparence) s’y sont ajoutés, comptant pour 10 % chacun.
Permanence : le grand flou
Le marché volontaire de la compensation carbone pour les particuliers repose sur des mécanismes complexes, auxquels nombre de chercheurs de partout dans le monde apportent des réponses différentes. Ainsi, Claude Villeneuve, de Carbone boréal, se montre très catégorique à l’effet que les compensations promises par les programmes basés sur la plantation d’arbres pourraient satisfaire au critère de permanence.
De nombreux chercheurs et organisations ne sont pas aussi affirmatifs. En entrevue avec Protégez-Vous, le spécialiste des politiques de lutte contre la déforestation au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Alain Karsenty, dit que « le problème de la permanence se pose tout particulièrement pour les forêts, la végétation, les sols agricoles également. Bien sûr, avec une forêt, vous pouvez stocker, mais pour neutraliser véritablement une émission, il faudrait que le stockage soit garanti sur plusieurs centaines d’années, pour avoir une compensation complète. Or, évidemment, certains arbres vivent plusieurs milliers d’années. Mais, dans un contexte d’augmentation des feux de forêt, des problèmes d’infestation par des insectes, d’événements climatiques comme les ouragans (qui mettent les arbres par terre), etc., des tas d’accidents peuvent se produire à tout moment, qui font qu’effectivement, les arbres plantés meurent. On n’est jamais en mesure de donner une garantie que cela va durer très longtemps. »
Le point de vue d’Alain Karsenty rejoint celui de Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal et directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal, qui était cité dans notre dossier : « Lorsqu’un arbre est planté, il est très difficile de garantir qu’il remplira les objectifs de séquestration de carbone souhaités. »
Augustin Fragnière, enseignant-chercheur à l'Institut des politiques territoriales et de l'environnement humain de l'Université de Lausanne et auteur du livre La compensation carbone : illusion ou solution ?, signale les mêmes limites, tout comme le fait la vaste enquête consacrée à la compensation carbone parue en mai 2019 sur le site d’information ProPublica (voyez l’encadré « Ressources »).
Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Pierre Bernier (interrogé pour notre dossier, mais non cité pour des raisons de manque d’espace) nous avait aussi mentionné que « ce n’est pas si simple que ça d’avoir des projets certifiés de carbone forestier, et il y a quelques raisons à ça. Quand on parle de projet d’afforestation ou de boisement, la plupart du temps, il s’agit d’une séquestration de carbone à venir, puisque l’arbre n’a pas encore pleinement joué le rôle qu’on attend de lui. C’est une barrière importante à l’entrée. Quand on clique sur “compenser”, il s’agit de crédits qui vont peut-être venir dans le futur. Il peut se passer bien des choses entre-temps. »
Cette réflexion sur les effets de la compensation carbone dans le cadre de projets de plantations d’arbres, de forestation ou de lutte contre la déforestation dépasse les frontières du Québec. Les enjeux de la compensation doivent être pris en compte dans une perspective globale et collective, rappelle le cabinet-conseil français Carbone 4 dans son document intitulé Net Zero Initiative – Un référentiel pour une neutralité carbone collective, publié en avril 2020 (voyez l’encadré « Ressources » ci-dessous).
Considérant tous ces avis, Protégez-Vous a tenu pour acquis que les projets de plantation d’arbres ne pouvaient obtenir mieux que la cote « acceptable » au critère de la permanence. Nous avons cependant pris en considération, dans notre évaluation, les mécanismes mis en œuvre par plusieurs fournisseurs pour limiter les risques de non-permanence (par exemple les plantations-tampons, le suivi régulier des arbres et les méthodes pour garantir que le terrain de la plantation d’arbres ne risque pas de changer de statut).
Standards internationaux et normes volontaires
Pour être valide, une compensation doit être vérifiable. Il n’est pas réaliste de croire que chaque client fera une vérification en règle, par exemple en se plongeant dans la lecture d’immenses répertoires et en visitant les lieux où sont réalisés les projets de plantation d’arbres ou d’énergie renouvelable (surtout s’ils sont situés à l’étranger).
Pour un consommateur, la façon la plus sûre, mais surtout la plus simple de s’assurer que la compensation est vérifiable – et vérifiée – est de privilégier en premier chef les programmes qui disposent de certifications robustes, comme Verified Carbon Standard (VCS) ou Gold Standard (GS). D’autres fournisseurs ont également mis en place des mécanismes de vérification solides, et les consommateurs peuvent facilement s’informer de ces mécanismes à partir de leur site internet.
Il reste qu’il existe de réelles différences entre les fournisseurs en ce qui a trait aux mécanismes de validation et de vérification des compensations puisque, faut-il le répéter, le marché volontaire n’est pas réglementé. Les meilleures pratiques pointent toutefois dans la direction des certifications externes et reconnues à l’échelle internationale. C’est ce qui explique pourquoi certains fournisseurs comme Arbre-Évolution et L’Arbre de l’intercoopération ont obtenu la cote « mauvais » à plusieurs critères dans notre tableau. Par ailleurs, il ne suffit pas de choisir une norme et de la suivre soi-même, comme Arbres Canada explique le faire. Pour que les acheteurs soient certains de savoir ce qu’ils obtiennent, un organisme de certification reconnu doit confirmer que ses consignes sont bien suivies.
Nous avons aussi considéré que l’acheteur doit avoir facilement accès aux registres lui permettant de constater que « sa » compensation n’a été vendue qu’une fois. Sans registre accessible facilement en ligne, le programme Solutions Will ne pouvait ainsi pas obtenir une cote plus élevée pour l’achat unique, malgré sa vérification VCS (VERRA).
Et l’engagement social des programmes ?
À notre vision « mathématique » de la valeur des contributions, certains des fournisseurs de crédits carbone opposent une philosophie plus humaniste. Ainsi, pour SOCODEVI, le programme L’Arbre de l’intercoopération ne lutte pas seulement contre les changements, mais aussi contre la pauvreté. Jean Nolet, de Coop Carbone, souligne pour sa part que l’équipe d’Arbre-Évolution « mobilise les gens, améliore leur environnement et génère pour nos milieux de vie des retombées positives à la tonne ». D’autres fournisseurs se sont donné pour mission de sensibiliser et d’éduquer le public, ce qui est fort louable pour faire évaluer les mentalités au sujet de la crise climatique et favoriser des changements dans les comportements humains.
Ce type de programmes a certes de grandes qualités, et vous pourriez choisir d’y contribuer financièrement. Notre travail, à Protégez-Vous, était toutefois de vous indiquer quels programmes vous donnent vraiment l’assurance d’avoir compensé les émissions de GES que vous n’arrivez pas à réduire. En ce sens, nous croyons toujours que notre palmarès est un bon outil pour vous guider.
Rémi Leroux
Maude Tanguay
Julie Gobeil
RESSOURCES
Marché du carbone : crédits compensatoires (ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Québec)
Net Zero Initiative – Un référentiel pour une neutralité carbone collective
En anglais

Les experts de l’Association pour la protection des automobilistes (APA)...

Entretenir dentier, protège-dents et gouttières demande constance et dis...

Avant de choisir parmi nos modèles recommandés, vérifiez si votre montre...

Les fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas les seuls qui peuvent ten...















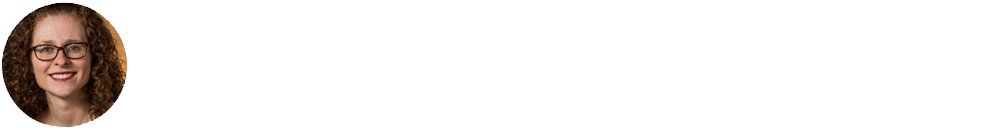
L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.