Bien connaitre les différents troubles alimentaires
Anorexie, boulimie, hyperphagie boulimique, les troubles alimentaires sont nombreux, et les comprendre permet d’en détecter rapidement les premiers signes pour bien accompagner ses proches atteints. Tour d’horizon des plus communs.
L’anorexie mentale
La boulimie
L’hyperphagie boulimique
Le trouble du comportement alimentaire restrictif ou évitant
Le trouble alimentaire non spécifié
La dysmorphie musculaire
L’orthorexie
Les troubles alimentaires atypiques
Les troubles alimentaires (TA) ont un impact important sur toutes les sphères de près d’un million de Canadiens, et peuvent même s’avérer fatals. Dans l’ensemble, ce sont des maladies mentales qui provoquent de graves perturbations dans l’alimentation quotidienne. Selon la National Initiative For Eating Disorders (NIED) du Canada, ils ont le taux de mortalité global le plus élevé de toutes les maladies mentales, soit de 10 à 15 %. Il faut donc agir tôt.
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (ou DSM, l’abréviation du titre original de ce manuel étatsunien) est l’outil de classification communément utilisé pour définir les troubles mentaux dont ceux liés à l’alimentation. Revu en 2013, le DSM-5 en reconnaît officiellement trois: l’anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l’hyperphagie boulimique. Outre ces syndromes, il existe également des troubles alimentaires dits d’évitement ou de restriction, catégorie dont fait partie l’orthorexie, qui se caractérise par une fixation sur l’ingestion d’une nourriture saine, le trouble alimentaire non spécifié et la dysmorphie musculaire.
Qui est affecté par les troubles alimentaires ?
Les troubles de l’alimentation apparaissent généralement au cours de l’adolescence ou au début de l’âge adulte. L’anorexie et la boulimie affectent principalement les filles et les femmes. Malgré cela, les garçons et les jeunes hommes ne sont pas épargnés: on considère que 10 % des personnes touchées sont de sexe masculin. Contrairement aux idées reçues qui voudraient que les adolescents soient les plus affectés, la plupart des personnes atteintes de troubles de l’alimentation ont en moyenne près de 30 ans.
Peut-on prévenir les troubles alimentaires ?
L'éducation et la prévention sont les meilleurs outils pour éviter les troubles alimentaires, notamment auprès des enfants et des adolescents. À la maison, l'alimentation doit occuper une juste place, où le plaisir apparait comme la motivation première. Certains parents veulent parfois tellement bien faire (ou à l'inverse craignent de mal faire les choses) qu'ils mettent une pression indue sur leur enfant ou leur transmettent leurs craintes (en matière de santé, de poids ou autres). Jusqu'à l'âge de cinq ans, le refus de manger d'un enfant ne doit pas se transformer en situation de confrontation ou de blocage systématique.
Quelles en sont les causes ?
Les causes qui entrainent ces différents types de maladies mentales sont multifactorielles.
- Les facteurs biologiques: Ils comprennent notamment l’hérédité, les antécédents familiaux de dépression, d’anxiété et de troubles de l’alimentation et les problèmes de poids. Les facteurs génétiques permettent de dire qu’il peut y avoir transmission de traits de tempérament ou d’une vulnérabilité à certaines perturbations qui augmenteraient le risque de développer un trouble alimentaire.
- Les facteurs psychologiques: Les troubles affectifs, l’anxiété (avec ou sans antécédents familiaux), la difficulté à contrôler ses impulsions, l’émotivité négative, le perfectionnisme mal placé et le contrôle extrême des émotions sont autant de facteurs psychologiques qui peuvent entrer en compte dans l’explication d’un trouble de l’alimentation.
- Les facteurs sociaux: Le culte du corps et le modèle de beauté centré sur la minceur, voire la maigreur ont un impact considérable sur les jeunes. Ces pressions sociales ont un lien avec les différentes formes de boulimie, mais pas avec l’anorexie, qui existe dans de nombreuses cultures où le modèle de minceur n’est pas la norme.
À tout cela s’ajoute un facteur déclencheur majeur: la restriction calorique. Chez les personnes dont les prédispositions génétiques sont favorables aux troubles de l’alimentation, le trouble de l’alimentation apparait la plupart du temps à la suite d’une diète.
Comment savoir si une personne en souffre ?
Il n’est pas évident de savoir si une personne développe un trouble de l’alimentation. Il existe toutefois des signes annonciateurs qu’il est possible de repérer. L’altération de l’estime de soi et un certain repli social peuvent être préoccupants, surtout s’ils sont associés à des comportements alimentaires problématiques. La personne qui souffre va par ailleurs avoir le sentiment d’être grosse alors que son poids est normal, voire même sous la normale. Elle sera constamment préoccupée par la nourriture, par son poids, par le regard des autres.
Dans les premiers temps, qui sont souvent une période de déni, il est fréquent que la personne malade refuse de considérer qu’un problème existe. Elle peut également manifester de l’impatience ou de l’intolérance envers les autres et avoir des difficultés à se concentrer (avec pour conséquence une baisse des résultats scolaires, par exemple). Mis bout à bout, tous ces signes sont préoccupants et doivent résonner comme un signal d’alarme pour les proches.
Enfin, il existe des questionnaires qui permettent d’évaluer si une personne risque de développer des TA. Anorexie et Boulimie Québec (ANEB Québec) propose par exemple un questionnaire en ligne, qui doit être considéré comme «un point de départ» et absolument pas comme un outil de diagnostic. Des questionnaires cliniques sont utilisés par des personnes formées et compétentes.
Afin de vous aider à mieux reconnaitre et comprendre les principaux troubles alimentaires, nous avons élaborés une série de fiches avec de Tania Lemoine, fondatrice de la clinique BACA, spécialisée en troubles alimentaires, et auteure du livre L’espoir à table, et Josée Lavigne, responsable des volets éducation et prévention d’Anorexie et boulimie Québec.
À lire aussi, notre entrevue avec la Dre Holly Agostino, directrice du programme des troubles alimentaires de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
L’anorexie mentale : vouloir perdre du poids à tout prix
Cette maladie, qui touche environ 4 % des femmes, se caractérise par une recherche de la minceur et une peur extrême de prendre du poids. Elle peut devenir mortelle si elle n’est pas prise en charge.
Souvent appelée simplement « anorexie », l’anorexie mentale est un TA restrictif. Les personnes atteintes cherchent constamment à perdre du poids et craignent d’en prendre. Même si elles en perdent beaucoup, leur perception de leur image corporelle reste déformée, et elles ne se trouvent jamais assez minces.
L’anorexie est souvent évolutive : de quelques inquiétudes liées à l’alimentation ou au poids à l’essai de régimes alimentaires, la personne atteinte voit son anxiété augmenter au fur et à mesure qu’elle perd du poids.
Les personnes anorexiques désirent contrôler ce qu’elles ingèrent et restreignent leur alimentation en scrutant attentivement tout ce qu’elles consomment, comptant la moindre calorie. Certaines font aussi de l’activité physique compulsivement.
Du tiers à la moitié des personnes souffrant d’anorexie se gavent de nourriture par moments ou utilisent des méthodes purgatives comme se faire vomir ou prendre des laxatifs.
À force de restreindre leur alimentation, elles finissent par manquer de nutriments essentiels, et leur corps s’affaiblit, ce qui peut mener à des problèmes de santé très graves, voire à la mort. En effet, plus les muscles s’affaiblissent, plus le cœur devient fragile, ce qui peut entrainer arythmies et arrêts cardiaques.
Prévalence : L’anorexie mentale survient habituellement à l’adolescence ou au début de l’âge adulte mais, rarement avant la puberté ou après l’âge de 40 ans. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à en être atteintes que les hommes : elles comptent pour près de 90 % des cas diagnostiqués, selon le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie. Environ 4 % des femmes développeront ce trouble au cours de leur vie.
Signes et symptômes :
- Perte pondérale importante, peu importe le poids initial;
- Préoccupation parfois obsessive et commentaires par rapport à son poids;
- Inquiétude quant au nombre de calories ingérées;
- Exercice de manière compulsive pour « bruler des calories »;
- Excuses fréquentes pour ne pas avoir à manger;
- Isolement et évitement des évènements sociaux où de la nourriture sera servie;
- Divers problèmes de santé causés par la malnutrition (arrêt des menstruations, frilosité permanente, perte de cheveux ou de poils, sentiment de faiblesse générale);
- Augmentation de l’irritabilité, de l’anxiété ou de la dépression;
- Déni d’avoir un problème ou d’avoir besoin d’aide.
Traitement : Sans traitement, l’anorexie mentale grave est fatale dans près de 10 % des cas. Le décès est causé par les complications du trouble ou par un suicide, d’où l’importance d’une prise en charge rapide et adéquate. Lorsque la maladie est traitée, environ la moitié des personnes reprennent complètement ou presque le poids qu’elles avaient perdu, et les problèmes physiques disparaissent. L’autre moitié aura des rechutes, qui varieront en gravité, au cours du reste de leur vie.
L’anorexie est généralement prise en charge par une équipe multidisciplinaire (médecin, psychologue, nutritionniste) détenant une expertise en TA. Celle-ci aide la personne à retrouver de saines habitudes alimentaires, à recevoir de l’aide physique et psychologique, et à reprendre le poids perdu. Des thérapies familiales sont aussi suggérées pour accompagner les proches des jeunes atteints d’anorexie. Dans les cas les plus graves, l’hospitalisation permet de reprendre le poids nécessaire au bon fonctionnement du corps en assurant un contrôle de l’alimentation et un suivi des signes vitaux.
La boulimie : une maladie invisible
Alternant entre gavage de nourriture et méthodes purgatives comme des vomissements pour éviter de prendre du poids, les personnes boulimiques passent souvent inaperçues.
La boulimie, également connue sous le nom de boulimie nerveuse ou de boulimie mentale, est un trouble de l’alimentation qui se caractérise par des épisodes récurrents de frénésie alimentaire. La personne ingère une quantité importante de nourriture en peu de temps, par exemple à la suite d’un évènement stressant, et alterne ces épisodes avec des méthodes dites « compensatoires » pour ne pas prendre de poids (vomissements forcés, laxatifs, périodes de jeûne, exercice).
À la suite de ces évènements, la personne se sent honteuse et en détresse, et cherche à s’isoler. En raison des méthodes compensatoires, les gens atteints de boulimie ne gagnent pas nécessairement de poids, et ce dernier se situe habituellement dans les limites de la normale selon le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie.
Pour recevoir un diagnostic de boulimie, il faut avoir au moins un épisode de frénésie alimentaire et de méthode compensatoire par semaine pendant minimalement trois mois. Le DSM-5 classifie le trouble selon plusieurs niveaux de gravité, soit de léger (1 à 3 comportements compensatoires par semaine) à extrême (14 comportements compensatoires ou plus par semaine).
Il est peu commun qu’une personne boulimique devienne anorexique par la suite, mais cette transition, souvent temporaire, s’observe dans 10 à 15 % des cas. De plus, les personnes boulimiques sont davantage conscientes de leur comportement et ressentent plus de culpabilité que celles qui sont anorexiques. Elles présentent à la fois un risque d’adopter des comportements impulsifs ou d’être atteintes de dépression et une inclination à se confier à un proche ou à un professionnel de la santé.
Ce TA peut par ailleurs entrainer certains troubles de santé physique. Les vomissements répétitifs risquent, par exemple, de causer des dommages à l’œsophage ou de diminuer le taux de potassium dans le sang, ce qui peut affecter le cœur.
Prévalence : La boulimie touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Le trouble est davantage répandu chez les femmes que chez les hommes, et on estime qu’environ une jeune femme sur cent en souffre. Selon le DSM-5, 10 % des personnes boulimiques sont des hommes.
Signes et symptômes :
- Préoccupation par rapport à son poids et à son apparence qui peut mener à des régimes ou à des restrictions pour maigrir;
- Signes de méthodes compensatoires comme des allers-retours aux toilettes après les repas;
- Inconfort à manger en public;
- Épisodes de frénésie alimentaire en secret;
- Sentiment de perte de contrôle lors des frénésies alimentaires;
- Isolement et arrêt des activités habituelles;
- Sentiment de culpabilité et de honte, et mauvaise estime de soi.
Traitement : On recourt généralement à la thérapie cognitivo-comportementale pour aider la personne à changer ses habitudes alimentaires et son image de soi. Selon les études, ce type de thérapie permet de traiter les frénésies alimentaires et les comportements compensatoires chez 30 à 50 % des patients. Dans certains cas, le médecin peut prescrire des antidépresseurs pour réduire la fréquence des crises de frénésie alimentaire et de vomissements ainsi que les symptômes d’anxiété et de dépression.
L’hyperphagie boulimique : un trouble alimentaire qui touche principalement les adultes
L’hyperphagie boulimique, ou binge-eating disorder, consiste à manger compulsivement de grandes quantités de nourriture sur une courte période. Ce trouble alimentaire entraine des risques d’obésité et une grande détresse.
L’hyperphagie boulimique consiste à consommer de grandes quantités de nourriture rapidement et de façon répétée. Lorsque ces crises de frénésie alimentaire (accès hyperphagiques) surviennent, la personne sent qu’elle perd le contrôle de la quantité d’aliments qu’elle ingère.
Contrairement à la boulimie, l’hyperphagie boulimique n’inclut pas de méthodes compensatoires comme des vomissements ou de l’exercice physique intense à la suite des épisodes de frénésie alimentaire. Ainsi, ce trouble s’accompagne souvent d’un gain de poids important – pouvant se rendre jusqu’à l’obésité – susceptible d’engendrer des problèmes de santé comme le diabète de type 2 ou de l’hypertension s’il n’est pas traité rapidement.
À la suite des épisodes de frénésie alimentaire, les personnes atteintes se sentent inconfortables en raison de la grande quantité de nourriture ingérée, et peuvent ressentir du dégout, de la culpabilité ou même de la déprime. Elles vivent de la détresse, car elles ont tendance à s’isoler par honte de leur comportement, et les compulsions alimentaires se passent majoritairement en secret.
Pour être considéré comme étant atteint de ce trouble, il faut avoir au moins un épisode de frénésie alimentaire par semaine pendant un minimum de trois mois. Le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie, le classifie selon plusieurs niveaux de gravité en fonction du nombre d’accès hyperphagiques par semaine, soit de léger (de 1 à 3) à extrême (14 ou plus).
Prévalence : L’hyperphagie boulimique survient à tout âge, mais elle est plus commune chez les adultes, et affecte presque autant les hommes que les femmes. Environ 3,5 % des femmes et 2 % des hommes en souffrent. Cette prévalence augmente toutefois chez les personnes en surpoids, puisqu’on estime que 30 % des gens atteints d’obésité ont aussi ce trouble. Chez les adolescents, la prévalence est estimée à 1,8 %.
Signes et symptômes :
- Épisodes de frénésie alimentaire, en cachette;
- Évitement des occasions de manger en public ou avec des proches;
- Fluctuations pondérales, souvent marquées par une prise de poids;
- Sentiment de honte, de culpabilité et de désespoir après les épisodes de frénésie alimentaire;
- Faible estime de soi;
- Symptômes gastro-intestinaux causés par l’ingestion d’une trop grande quantité d’aliments (ballonnements, diarrhée, reflux gastrique).
Traitement : Des études cliniques ont conclu que la thérapie cognitivo-comportementale et la psychothérapie interpersonnelle aidaient à contrôler les épisodes de frénésie alimentaire. Le médecin prescrit, dans les cas graves, des suppresseurs d’appétit ou d’autres médicaments qui ont comme effet secondaire de réduire la faim (des stimulants ou certains antidépresseurs).
Le trouble du comportement alimentaire restrictif ou évitant : au-delà de se montrer « difficile »
Refus de manger, dégout pour certains aliments, les manifestations de ce trouble alimentaire restrictif assez répandu chez les personnes atteintes de maladies neurodéveloppementales peuvent entrainer de graves carences alimentaires.
Communément appelé ARFID (avoidant/restrictive food intake disorder) ou TCARÉ, ce TA restrictif se caractérise par une alimentation très sélective, un refus de manger certains aliments ou simplement un désintérêt pour la nourriture. Les restrictions peuvent être liées à une hypersensibilité à certaines textures, odeurs ou couleurs. Elles ne sont cependant pas causées par des pratiques culturelles comme un jeûne religieux, une maladie physique ou un traitement médical.
Le refus de manger s’accompagne parfois d’anxiété, comme une peur d’être malade, ou apparaitre à la suite d’un évènement traumatisant, comme un étouffement ou une réaction allergique. Bien qu’il puisse se développer à l’âge adulte, ce trouble se manifeste habituellement au cours de l’enfance.
Les restrictions des personnes atteintes de TCARÉ sont beaucoup plus graves que celles qui sont liées à de simples caprices alimentaires, puisqu’elles entrainent une perte de poids, une diminution des fonctions corporelles de base et un retard de croissance chez les jeunes. Elles influent aussi grandement sur la vie sociale et le quotidien.
À la différence de l’anorexie, avec laquelle ce trouble peut être confondu, le TCARÉ n’a pas pour motivation une perte de poids, et les personnes atteintes ne présentent pas de perturbation de leur image corporelle.
Prévalence : Il existe peu de données sur la prévalence exacte de ce trouble. Les études cliniques estiment que de 0,5 % à 5 % des enfants et des adultes de la population générale sont atteints de TCARÉ, et que ce dernier affecte autant les individus des deux sexes. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles anxieux, de maladies neurodéveloppementales (comme le spectre de l’autisme ou le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) et de trouble obsessionnel compulsif risquent davantage de développer ce TA, selon le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie. Chez les jeunes atteints d’autisme, la prévalence du TCARÉ serait plutôt de 12,5 % à 33,3 %.
Signes et symptômes :
- Perte de poids ou retard de croissance;
- Carences nutritionnelles importantes;
- Symptômes liés à un manque de nourriture (fatigue, étourdissements, difficultés de concentration ou problèmes de sommeil);
- Gouts extrêmement limités et exclusion de nombreux types d’aliments;
- Manque d’appétit ou d’intérêt pour la nourriture;
- Stress important ou dégout à l’idée de manger certains aliments;
- Peur constante de s’étouffer ou de vomir;
- Difficulté à participer à des activités sociales, comme voir des amis ou sortir au restaurant.
Traitement : La thérapie cognitivo-comportementale est l’approche la plus recommandée pour aider les patients à normaliser leur alimentation et à gérer leur l’anxiété par rapport à certains aliments. Lorsque le trouble est assez grave pour avoir entrainé une perte de poids ou des carences alimentaires importantes, une hospitalisation peut s’avérer nécessaire pour stabiliser l’état des patients. Il n’est pas rare que des suppléments alimentaires oraux ou même une nutrition entérale par sonde (gavage) soient indiqués pour pallier ces carences.
Non spécifié : quand le trouble alimentaire ne répond pas aux critères diagnostiques
Le trouble alimentaire non spécifié est le plus répandu dans la population. Il se caractérise par le fait qu’il ne répond pas à tous les critères diagnostiques d’autres TA.
Un trouble alimentaire est considéré comme non spécifié s’il ne répond pas aux critères d’autres TA, mais que les comportements de la personne atteinte ont un impact négatif dans plusieurs sphères de sa vie.
Par exemple, un individu pourrait présenter tous les symptômes de l’anorexie, mais n’avoir pas perdu assez de poids pour en recevoir un diagnostic formel; le trouble serait alors considéré comme une anorexie atypique. Quelqu’un qui a des crises de frénésie alimentaire, mais pas assez régulièrement pour recevoir le diagnostic d’hyperphagie boulimique, serait considéré comme atteint d’hyperphagie boulimique de faible fréquence ou de durée limitée.
Les TA non spécifiés regroupent aussi la boulimie de faible fréquence et/ou de durée limitée, le trouble purgatif et le syndrome d’alimentation nocturne.
Le trouble alimentaire non spécifié peut devenir très grave, puisque les personnes atteintes sont aussi susceptibles d’être hospitalisées que les adolescents qui souffrent d’anorexie mentale. Par ailleurs, les personnes atteintes présentent un risque aussi élevé de mourir des suites de leur affection que celles souffrant de troubles spécifiés. Certaines études ont même montré que le tiers des décès attribués à des troubles alimentaires étaient causés par un TA non spécifié.
Prévalence : Le trouble alimentaire non spécifié est le TA le plus commun : on estime que 3,8 % des femmes et 1,6 % des hommes recevront ce diagnostic au cours de leur vie.
Signes et symptômes :
Comme ce trouble regroupe plusieurs types de comportements alimentaires, les symptômes varient grandement d’une personne à l’autre, mais incluent :
- Préoccupation par rapport à son image corporelle ou à son poids;
- Comportement malsain et rigide envers l’alimentation;
- Fluctuations du poids;
- Élimination de certains aliments;
- Isolement et augmentation de l’anxiété ou d’autres troubles de l’humeur.
Traitement : Le traitement des troubles alimentaires non spécifiés ressemble à celui des autres TA et inclut la thérapie cognitivo-comportementale. Une approche multidisciplinaire menée par une équipe spécialisée (nutritionniste, psychologue et médecin) est généralement efficace.
La dysmorphie musculaire ou l’envie d’être toujours plus musclé
Entrainement excessif, prise de suppléments et même de stéroïdes sont des moyens auxquels recourent les personnes atteintes de dysmorphie musculaire (majoritairement des hommes), qui cherchent à devenir toujours plus musclées.
La dysmorphie musculaire, aussi appelée anorexie inversée ou bigorexie, est une dysmorphie corporelle incluse dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs et apparentés dans le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie. Elle se caractérise par la croyance que son corps est trop mince ou jamais assez musclé.
Les personnes atteintes, majoritairement des hommes et des athlètes, pratiquent des activités sportives de façon extrême afin d’atteindre un physique idéal sans jamais être satisfaites. Elles cherchent par tous les moyens à développer une masse musculaire disproportionnée par rapport à la normale, ce qui les amène à se surentrainer et à passer beaucoup de temps à faire du sport de façon compulsive.
Elles sont également très strictes sur le plan de leur alimentation et consomment parfois de nombreux suppléments ou stéroïdes anabolisants, comme de la testostérone, ce qui peut s’avérer dangereux en raison des nombreux effets secondaires potentiellement graves de ces substances (déficience du système immunitaire, hypertension artérielle, augmentation de l’agressivité).
Les personnes atteintes de dysmorphie musculaire délaissent leurs activités quotidiennes afin de se concentrer principalement sur les entrainements et éprouvent une grande culpabilité si elles ratent une séance. Le trouble cause habituellement une grande détresse chez elles, puisqu’elles passent de nombreuses heures par jour à se soucier de leur apparence sans aimer ce qu’elles voient.
Prévalence : Contrairement à la dysmorphie corporelle, plus fréquente chez les femmes, la dysmorphie musculaire touche davantage les hommes. Environ 2,2 % d’entre eux en seraient atteints, contre 1,4 % des femmes. La prévalence est beaucoup plus élevée chez les athlètes : environ 15 % de ceux-ci en sont atteints.
Signes et symptômes :
- Croyance obsessive que son corps devrait être plus musclé, même s’il l’est déjà;
- Rigidité de l’horaire des entrainements, de l’alimentation, et prise de suppléments;
- Sentiment négatif pouvant aller jusqu’à la honte par rapport à son apparence;
- Entrainement qui occupe de nombreuses heures par jour, au risque de causer des blessures;
- Liste de priorités qui fait passer l’entrainement avant le travail et les activités sociales;
- Grand sentiment de culpabilité si un entrainement doit être manqué.
Traitement : La dysmorphie musculaire est habituellement traitée comme la dysmorphie corporelle, c’est-à-dire par la thérapie cognitivo-comportementale. Comme le trouble peut causer une grande détresse chez ceux qui en sont atteints, la prise d’antidépresseurs est parfois nécessaire. En effet, on estime que 80 % des personnes atteintes d’un trouble de dysmorphie corporelle, tous troubles confondus, ont des idées suicidaires, et que de 25 à 30 % de ceux qui en souffrent tenteront même de mettre fin à leurs jours.
L’orthorexie : quand bien manger devient une obsession
Pour les personnes atteintes d’orthorexie, avoir une saine alimentation est primordial, au point où elles ressentent une forte anxiété si elles se retrouvent devant des aliments jugés malsains.
L’orthorexie est un phénomène de plus en plus répandu qui se caractérise par une obsession de l’alimentation saine. Si faire attention à son alimentation et vouloir bien manger est fortement encouragé dans la société, les personnes orthorexiques poussent ce désir à l’extrême. Elles pensent à leur alimentation en permanence et ressentent une forte anxiété à l’idée de manger quelque chose qu’elles jugent malsain, comme de la nourriture transformée, trop grasse ou trop sucrée.
La personne atteinte s’isole fréquemment, car elle s’angoisse à l’idée de ne pas contrôler ce qu’elle consomme. Elle aura tendance à éviter de manger au restaurant ou chez des proches. Comme l’orthorexie est une affection restrictive, il est possible qu’elle mène à de la malnutrition dans les cas graves.
L’orthorexie n’est pas encore reconnue officiellement comme un trouble alimentaire ni comme une maladie, et le DSM-5, le livre de référence utilisé en psychiatrie, n’en fait pas mention. Un débat persiste quant à savoir si elle devrait être reconnue comme un TA et ainsi répondre à des critères diagnostiques officiels. Il existe néanmoins le test de Bratman, qui permet d’évaluer si un souci de saine alimentation tend vers l’obsession.
Prévalence : Comme il n’existe pas encore de critères diagnostiques de l’orthorexie, il est difficile d’estimer la prévalence réelle du trouble, mais selon Anorexie et boulimie Québec, de plus en plus de gens consultent à ce sujet. Des études ont démontré que de nombreuses personnes atteintes d’orthorexie présentent également un trouble obsessionnel compulsif.
Signes et symptômes :
- Obsession de la saine alimentation allant au-delà d’un simple désir de bien manger;
- Élimination croissante de certains groupes d’aliments (produits sucrés, gras, transformés);
- Incapacité de manger autre chose qu’un groupe restreint d’aliments considérés comme « sains »;
- Consultation obsessive et systématique des listes d’ingrédients et des valeurs nutritives;
- Pensées concernant la nourriture qui occupent l’esprit plusieurs heures par jour;
- Anxiété à l’idée de manger quelque chose qui a été préparé par quelqu’un d’autre;
- Jugement envers les comportements alimentaires « malsains » des autres;
- Isolement social.
Traitement : Puisque l’orthorexie n’est pas encore reconnue comme une maladie, elle n’a pas de traitement spécifique. Les experts la traitent comme une forme d’anorexie ou de trouble obsessionnel compulsif. Ainsi, l’approche préconisée inclut une prise en charge multidisciplinaire qui comprend de la psychothérapie et l’expertise d’un nutritionniste pour éliminer l’anxiété associée à la consommation d’aliments jugés malsains.
Des troubles alimentaires atypiques… et rares
Il existe également des troubles alimentaires atypiques, comme le pica, le mérycisme ou la potomanie. Des affectations rares qui peuvent toucher les enfants en bas-âge, autant que les adultes.
La potomanie se caractérise par un besoin irrépressible de boire constamment et en grande quantité n’importe quel liquide, mais principalement de l’eau. Les conséquences peuvent être dramatiques, car les reins et l’organisme de la personne atteinte ne peuvent absorber autant d’eau. Cette surcharge peut entraîner une prise de poids, des œdèmes, voire le décès. Ce trouble touche en majorité des personnes atteintes de déséquilibres psychiatriques.
Le mérycisme, ou rumination, est une réaction incontrôlable qui consiste à rappeler dans la bouche les aliments qui viennent d’être avalés et qui se trouvent déjà dans l’estomac. Il ne s’agit pas d’un vomissement, d’une crise compulsive alimentaire ni d’un reflux gastrique. La personne atteinte ne le fait pas volontairement et subit donc totalement cette situation. Le mérycisme touche principalement les enfants en bas âge (jusqu’à un an), plus rarement les adultes. Dans la mesure où il s’agit d’un trouble atypique rare, il n’existe pas de traitement approprié ni de thérapie particulière. Il arrive que la rumination soit associée à une anorexie mentale ou à la boulimie.
Le pica consiste en l’ingestion irrésistible d’objets ou de substances non comestibles sur une période de plus d’un mois: sable, cheveux, écailles de peinture, rouille, plastique, cendre de cigarette… Le pica se manifeste généralement à l’âge de un ou deux ans, mais des adultes peuvent également en être affectés, en particulier ceux qui souffrent de troubles psychiatriques.
La carpophobie est la phobie des fruits, un type de répulsion très rare mais dont les conséquences sur l’organisme peuvent être importantes puisque l’absence d’apports nutritifs peut provoquer un dérèglement métabolique. La perte de cheveux peut être une manifestation physique de carpophobie.
La néophobie alimentaire, c’est le «j’aime pas» des enfants de deux à cinq ans qui refusent de gouter de nouveaux aliments, un passage normal dans le développement de l’enfant mais qui, s’il persiste, peut relever d’un trouble anxieux.
La phobie de la déglutition apparait très souvent à la suite d’un traumatisme (étranglement avec un aliment, fausse route, etc.). De peur de revivre l’événement douloureux, la personne refuse les morceaux et ne se nourrit que d’aliments liquides.
Le syndrome d’alimentation nocturne n’est pas considéré officiellement comme un trouble de l’alimentation, mais il s’en rapproche par l’obsession alimentaire qui le caractérise: des compulsions boulimiques qui surviennent durant la nuit dans un état proche du somnambulisme.
Ressources utiles
Ligne d’écoute d’Anorexie et boulimie Québec : 1 800 630-0907 / 514 630-0907
National Eating Disorders : association américaine, où on retrouve plusieurs ressources comme des guides et des statistiques sur les troubles alimentaires (en anglais)

Pour souligner le Mois national de l’histoire autochtone, célébré en jui...

L’une des meilleures barres de son de notre test coûte autour de 3 000 $...
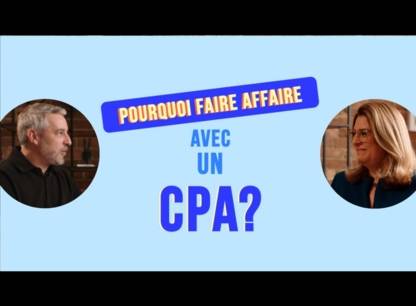
Notre journaliste explore les raisons de faire affaire avec un comptable...

L’objectif, c’est de ralentir la formation de rouille en éliminant les a...






L'envoi de commentaires est un privilège réservé à nos abonnés.
Déjà abonné? Connectez-vous
Il n'y a pas de commentaires, soyez le premier à commenter.