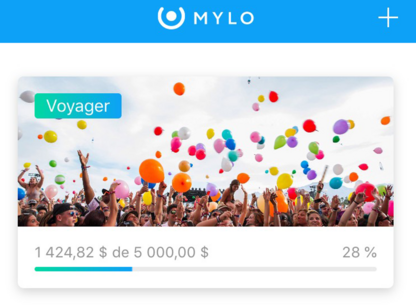Dans notre numéro du mois de juin, nous consacrons un dossier à la consommation responsable et à ses nombreuses facettes : simplicité volontaire, zéro déchet, lutte au gaspillage alimentaire ou vestimentaire, économie de partage, déconsommation, investissement éthique, etc.
Pour les bienfaits de cet article, nous avons sollicité nos lecteurs via la page Facebook de Protégez-Vous. Nous avons reçu de nombreux témoignages de gens qui avaient entrepris de changer radicalement leur façon de consommer, au point de repenser leur rapport au monde : protéger l’environnement et leur santé, oui, mais également partager, échanger et recréer des liens dans la communauté.
Dans 95 % des cas, les personnes qui nous ont écrit étaient des femmes. Tiens donc! Pour comprendre les raisons de cette surreprésentation, j’ai demandé son opinion à Fabien Durif, directeur de l’Observatoire de la consommation responsable, qui intervient dans notre dossier. Selon lui, certaines tendances de la consommation responsable confirment des différences de comportement entre femmes et hommes. « Les femmes sont, par exemple, plus axées sur la déconsommation ou le recyclage que les hommes », illustre-t-il.
Autre exemple : le gaspillage alimentaire. À partir d’une série de groupes de discussions organisés avec des consommateurs, Fabien Durif a constaté que le changement comportemental semble plus difficile à appréhender chez les hommes.
La répartition des rôles dans le quotidien des familles peut en partie expliquer cette prise de conscience plus marquée chez les femmes car ce sont elles qui, encore majoritairement, prennent les décisions d’achat, amorcent une réflexion et impulsent un changement de comportement au sein de la famille. De quoi alourdir un peu plus la « charge mentale » des femmes, sujet dont on discute beaucoup ces derniers jours sur les réseaux sociaux.
« Changements de comportement et de style de vie »
Dans un rapport intitulé L’intégration du genre dans la lutte aux changements climatiques au Québec (2013), j’ai trouvé matière à alimenter cette réflexion sur l’écologie et le genre. Les chercheuses de l’UQAM à l’origine de ce travail rappellent que «les femmes ont une meilleure compréhension du phénomène des changements climatiques et expriment une plus grande préoccupation pour cet enjeu que les hommes».
En s’appuyant sur diverses études, les auteures expliquent qu’hommes et femmes n’envisagent pas, par exemple, les réductions de gaz à effet de serre (GES) de la même façon. «Les femmes, écrivent-elles, privilégient les changements de comportement et de style de vie (consommation) au niveau individuel (et des familles) tandis que les hommes envisagent généralement des solutions techniques et technologiques.»
Des perceptions très différentes, mais qui peuvent avoir des impacts concrets. Dans une étude suédoise publiée par l’Environment Advisory Council (rattaché au ministère de l’Environnement) en 2007, j’ai découvert que l’empreinte écologique laissée par les hommes et par les femmes n’est pas la même. Ces dernières, explique l’auteur, vivent d’une manière plus durable, laissent une empreinte plus faible sur leur environnement et participent moins aux changements climatiques.
D’autres facteurs – les inégalités salariales, en particulier – peuvent également influencer les comportements de consommation et expliquer certaines différences hommes-femmes. Serge Mongeau, médecin et auteur du livre La simplicité volontaire en 1985 que j’ai interrogé pour notre dossier, rappelle que les motivations qui poussent au changement varient beaucoup d’une personne à l’autre. Selon lui, «ces cheminements sont cependant campés dans une critique de plus en plus marquée de la société de consommation, et une critique de ses répercussions sur nos vies et notre environnement». Sans distinction de genre.